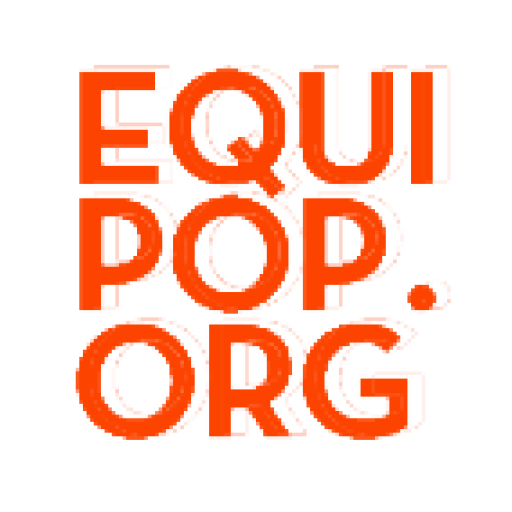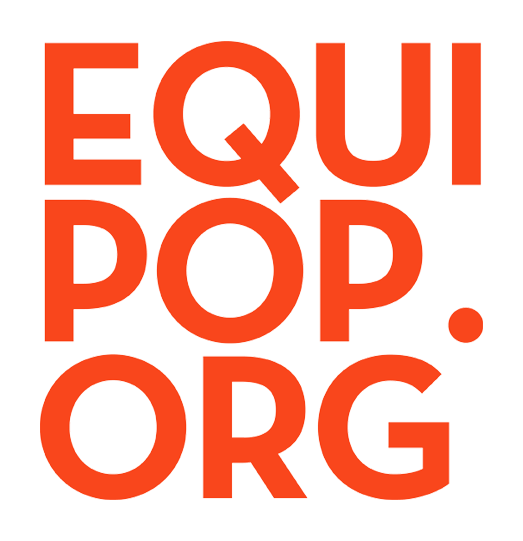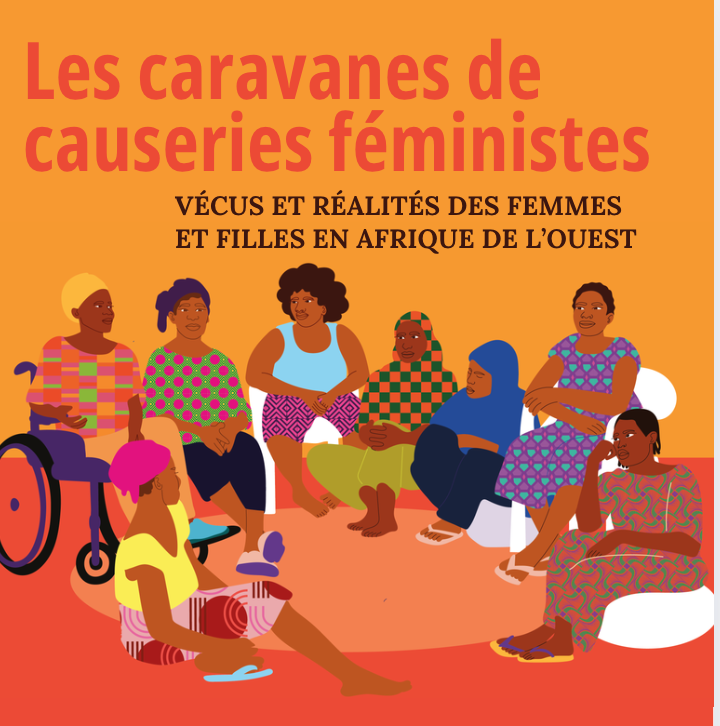
-Les caravanes de causeries féministes : une mobilisation inspirante pour les voix des femmes en Afrique de l’Ouest
Dans un contexte où les droits des femmes et des filles continuent d’être bafoués, des militantes féministes d’Afrique de l’Ouest, soutenues par Equipop, ont mis en place une initiative ambitieuse : les caravanes de causeries féministes. Organisée dans huit pays de la région (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal), cette initiative a mobilisé plus de 60 militantes féministes en 2022 et 2023 pour aller à la rencontre de près de 1 500 femmes et filles issues de milieux divers.
Cette initiative et les échanges qui en ont résulté ont donné naissance à un rapport rédigé par des consultantes féministes et issues des retours des militantes. Ce Rapport, fruit d’une méthodologie féministe intersectionnelle, offre une analyse approfondie des réalités des femmes et des filles rencontrées, et se distingue par son approche inclusive et participative. Il dresse un état des lieux des réalités vécues par ces femmes et filles, met en lumière les violences sexistes et sexuelles auxquelles elles sont confrontées et analyse leurs besoins, ainsi que leurs attentes vis-à-vis des mouvements féministes et des politiques publiques.
Retour sur une expérience féministe inspirante qui met en lumière les luttes, les attentes et les aspirations des femmes.
Une démarche féministe intersectionnelle et participative
Les caravanes ont été organisées sous forme de focus groups, permettant de donner la parole à plus de 1 000 femmes et jeunes filles de différents horizons. L’objectif ? Changer de posture et écouter les femmes et les filles à qui on donne peu la parole, recueillir leurs témoignages sur les expériences liées aux inégalités de genre et aux violences sexistes et sexuelles, comprendre leurs priorités et renforcer les liens entre militantes féministes et ces femmes et filles rencontrées. Cette initiative repose sur une approche féministe intersectionnelle, prenant en compte les oppressions multiples que peuvent subir les femmes et les personnes rencontrées selon leur statut social, leur situation économique ou encore leur appartenance ethnique.
Des résultats éclairants sur la perception du féminisme et des droits des femmes
Les discussions au sein des caravanes ont mis en lumière une méconnaissance du concept de féminisme, souvent perçu de manière caricaturale. Pour certaines participantes, une féministe est une femme autonome et engagée ; pour d’autres, elle est vue comme une insoumise, une rebelle, voire une menace pour l’ordre social établi. De nombreuses femmes présentes, notamment en milieu rural, ont affirmé ne pas se reconnaître dans les luttes féministes urbaines, qu’elles jugent éloignées de leurs réalités quotidiennes.
Ces mêmes femmes rencontrées dénoncent les injustices qu’elles subissent : violences domestiques, mariages forcés, absence d’accès aux soins, précarité économique, etc. Paradoxalement, elles reconnaissent également l’importance des associations de défense des droits des femmes et des associations féministes qui, malgré les préjugés à leur égard, sont souvent les seules à leur venir en aide en cas de violences.
La sororité a été un thème central des discussions. Pour beaucoup, elle ne se résume pas à un concept abstrait, mais représente une solidarité concrète et quotidienne entre les femmes. Certaines ont témoigné du rôle crucial des militantes féministes locales qui les accompagnent dans leurs démarches judiciaires, les soutiennent pour fuir des situations de violence ou leur apportent un soutien psychologique face aux traumatismes vécus.
Les violences sexistes : une réalité omniprésente
Les caravanes ont mis en lumière le continuum des violences sexistes et sexuelles, qui concerne tous les milieux sociaux et toutes les générations. Du harcèlement en milieu universitaire au mariage forcé, en passant par les mutilations sexuelles féminines (MsF) et les violences conjugales, les témoignages recueillis sont une nouvelle preuve que ces violences ne sont pas isolées, mais relèvent d’un système qui maintient les femmes dans une insécurité constante.
Certaines régions, en raison de conflits armés, connaissent également des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Au Burkina Faso, des femmes déplacées internes ont raconté les violences qu’elles subissent de la part de groupes armés. Cette situation souligne l’urgence d’une prise en charge renforcée des survivantes et de politiques publiques plus efficaces pour lutter contre l’impunité, notamment dans les situations de conflits.
Des Recommandations pour un changement structurel
Au-delà des différents constats sur les expériences des femmes et des filles rencontrées, le rapport des caravanes formule des recommandations clés à l’égard des acteur·rice·s pour l’égalité de genre :
🔹 Renforcer les campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes, y compris en milieu rural.
🔹 Mettre en place des dispositifs de signalisation des violences plus accessibles et sécurisés.
🔹 Améliorer l’accès à la justice pour les survivantes de violences, en luttant contre l’impunité.
🔹 Soutenir les initiatives féministes locales et renforcer les financements des organisations de terrain.
🔹 Intégrer pleinement les revendications des femmes en situation de marginalisation dans les politiques publiques et les actions féministes.
Ce rapport est un outil de plaidoyer puissant pour exiger des actions concrètes. Il doit être partagé, diffusé et utilisé comme base pour continuer à amplifier la voix des femmes invisibilisées.
Un appel à la sororité et à l’action collective
Ce rapport n’est pas qu’un simple constat ; il est aussi un appel à l’action et à la sororité. Les femmes rencontrées ont exprimé le besoin d’une solidarité plus forte entre elles, d’une entraide réelle face aux difficultés qu’elles rencontrent. En mettant en avant les voix des femmes et des filles à qui on donne peu la parole, les Caravanes de Causeries Féministes ont réussi deux paris audacieux : celui de créer des espaces de discussions pour les enjeux autour des droits des femmes et des inégalités de genre, et celui de renforcer les alliances entre militantes. Il reste maintenant à transformer ces discussions en actions concrètes pour que l’égalité de genre ne soit plus un simple sujet de discussion, mais une réalité tangible pour tou·te·s.