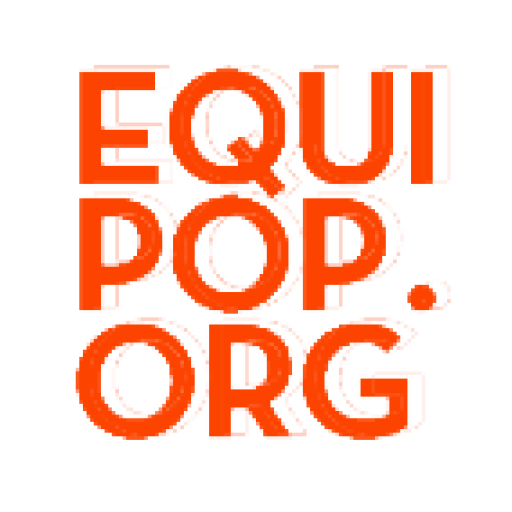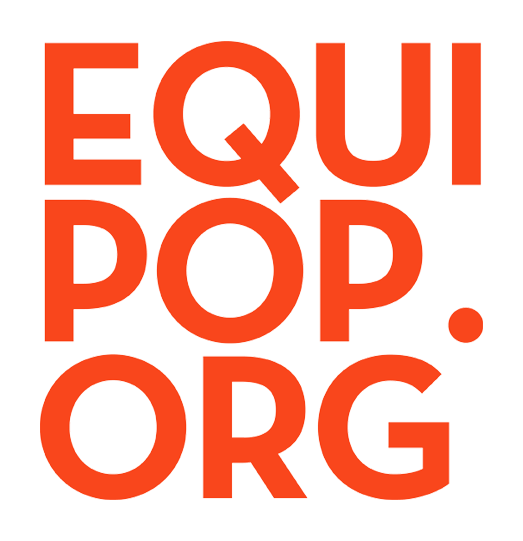Retour sur la CSW69 : face aux gouvernements conservateurs et à la montée du fascisme, les diplomaties féministes doivent s’imposer
Equipop a participé à la 69ème session de la Commission sur le statut des femmes, qui s’est tenue du 10 au 21 mars à l’ONU. Cette année marquait le 30ème anniversaire de l’adoption de la plateforme d’action de Pékin (Pékin+30), une feuille de route pour faire avancer l’égalité de genre et les droits des femmes dans le monde. A cette occasion, et dans un climat de montée du fascisme aux conséquences lourdes sur la teneur des débats, une déclaration politique a été adoptée par les Etats membres à l’ouverture de la commission.
La Commission sur le statut des femmes (CSW) s’est ouverte le 10 mars 2025, célébrant le 30ème anniversaire de l’adoption de la plateforme d’action de Pékin par les Etats membres des Nations unies (ONU). Ce document historique est considéré à ce jour par de nombreux Etats et organisations de la société civile (OSC) comme la feuille de route onusienne la plus progressiste sur les questions de droits des femmes et d’égalité de genre à l’international. Elle identifie 12 domaines d’actions et un ensemble de recommandations vis-à-vis des Etats pour faire avancer l’égalité de genre, au niveau national et international. Cette année, la CSW a permis de faire l’état des lieux de cette avancée et de prendre de nouveaux engagements politiques pour poursuivre la mise en oeuvre de la plateforme de Pékin.
Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a alerté les Etats : le “poison” du patriarcat assiège les droits des femmes, en particulier les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR). Il a déploré les pressions grandissantes exercées sur la société civile, la baisse alarmante des financements aux organisations féministes, et le manque de volonté politique des Etats pour faire réellement progresser les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+.
C’est dans ce contexte que lors de la session d’ouverture, les Etats membres de la CSW ont adopté une déclaration politique, après plusieurs semaines de négociations rendues difficiles par la présence renforcée d’Etats conservateurs comme les Etats-Unis ou l’Argentine. S’il était symboliquement important que les Etats parviennent à s’accorder sur un texte pour Pékin+30, la recherche de compromis pour parvenir à une adoption par consensus s’est malheureusement faite au détriment des DSSR. Après avoir joué un rôle d’appui technique dans les négociations, il était essentiel qu’Equipop et ses allié·es féministes participent à la CSW et se mobilisent face à l’offensive réactionnaire dans les espaces multilatéraux, qui se manifeste de manière criante à travers l’administration Trump.
Un contexte géopolitique hostile aux droits des femmes et à l’égalité de genre pour Pékin+30
Les Etats membres de l’ONU se sont réunis à New York dans un climat géopolitique particulièrement hostile à la solidarité internationale et à l’égalité de genre, deux mois après l’investiture de Donald Trump et les divers décrets présidentiels qui ont attaqué tour à tour l’aide publique au développement, le climat, la lutte contre le VIH, les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Le nouveau gouvernement américain s’attaque à “l’idéologie de genre” au profit d’une “vérité biologique”, ayant supprimé toute mention faite du mot genre sur les sites officiels des différentes administrations. Cette rhétorique réduit les femmes à leur corps et leurs fonctions reproductives, et s’illustre par toutes les mesures transphobes mises en place par le gouvernement. Donald Trump a également réintégré les Etats-Unis à la “Déclaration du consensus du Genève”, un texte sans valeur juridique, mais qui vient réaffirmer l’opposition des Etats signataires au droit à l’avortement.
L’offensive anti-droits des Etats-Unis intervient dans un contexte où partout dans le monde, et notamment en Europe (France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande, Suède, Allemagne…), les Etats ont décidé de couper massivement leurs budgets d’aide publique au développement (APD). Ces coupes ont des impacts sans précédent sur le financement des organisations multilatérales, le travail des organisations féministes et plus largement sur l’égalité de genre.
Ce contexte a imprégné la teneur des négociations sur le texte de déclaration politique, ainsi que les prises de parole en séance plénière, où les Etats-Unis, qui ne sont pourtant pas membres de la CSW, ont porté une voix ultra-conservatrice aux côtés de l’Argentine de Javier Milei, du Vatican, de la Russie et de plusieurs Etats d’Afrique de l’Ouest. Dans toutes leurs interventions, les Etats-Unis se sont opposés à l’utilisation du mot “genre”, jusque dans l’expression “égalité de genre” consacrée dans la langue anglaise. Pendant le segment de haut niveau de la CSW, ils ont également parrainé et co-organisé un événement officiel avec deux organisations anti-droits basées aux Etats-Unis, portant sur “l’attaque de l’idéologie de genre sur les femmes et la famille”. Les Etats les plus conservateurs ont également essayé d’introduire des dispositions ambiguës sur “les femmes et la famille” : la famille était considérée comme “l’unité de base de la société”, la formulation limitait le rôle des femmes à celui de mères au sein de foyer, sans reconnaître la charge mentale disproportionnée qui repose sur elles en lien avec les tâches domestiques, ni les violences qui peuvent exister dans la cellule familiale.
Les droits et santé sexuels et reproductifs écartés de la CSW69
La déclaration politique adoptée à l’issue de ces négociations, le premier jour de la commission, a permis quelques avancées depuis la dernière adoptée en 2020. Ce texte n’est pas contraignant au même sens qu’un traité, mais il engage tout de même la communauté internationale. Il reconnaît par exemple la nécessité de lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), en ligne et hors ligne, plus particulièrement en temps de conflit, avancée considérable alors que cet enjeu est régulièrement posé comme une ligne rouge par des pays comme la Russie. La question du financement flexible, durable et à long terme de la société civile est reconnue comme un point critique pour atteindre l’égalité de genre. La déclaration réitère également la nécessité pour les Etats d’honorer leurs engagements en matière d’APD. Un langage fort a été inclus sur le thème de la santé, y compris la santé mentale, la santé menstruelle et la couverture universelle de santé.
Néanmoins, les DSSR ne sont pas du tout mentionnés dans le texte, alors que leur protection et promotion est indispensable à la pleine réalisation des droits humains des femmes et à l’égalité de genre. Le paragraphe sur l’éducation n’inclut pas l’éducation complète à la sexualité, qui est pourtant cruciale dans la prévention des VSS et la lutte contre le VIH. Il n’y a pas non plus de mention des droits humains des personnes LGBTQIA+, même si la déclaration reconnaît l’existence de formes multiples et intersectionnelles de discriminations qui pèsent sur les femmes et les filles.
Malgré une adoption de la déclaration par consensus, certains Etats se sont exprimés le dernier jour de la CSW en opposition à de nombreuses dispositions qu’elle contient. Les Etats-Unis ont ouvert la succession des prises de parole en s’opposant aux mentions de “droit aux développement”, “changement climatique”, “genre” et plus largement au cadre de l’Agenda 2030. L’Argentine, la Russie et le Burkina Faso ont refusé de reconnaitre les termes de “formes multiples et intersectionnelles de discriminations” et ont souligné qu’ils intéprétaient le terme “genre” uniquement à travers un prisme binaire et biologique femme/homme. La Russie s’est également opposée à la notion de droits humains de manière globale.
Des Etats comme le Canada (au nom de la coalition d’Etats “Mountains”), le Chili (au nom de la coalition d’Etats LATAM), la Pologne (au nom de l’UE), le Brésil ou encore la Tunisie se sont néanmoins réjouis de l’adoption de la déclaration. Seuls les Etats d’Amérique du Sud ont explicitement regretté l’absence des DSSR du texte.
La voix de la société civile comme rempart face aux conservatismes
Face à la virulence des acteurs anti-droits, la société civile s’est mobilisée au cours des deux semaines de commission à travers un grand nombre d’événements auxquels Equipop a participé. Les DSSR ont été replacés au coeur des discussions, et la question de la montée du fascisme était particulièrement prégnante. Des associations féministes comme AWID, Outright International, l’Institute for Journalism and Social Change ou encore le Planning familial ont agi en lanceuses d’alerte, en insistant sur les liens entre la rhétorique anti-genre, les Big Tech et l’autoritarisme, et en créant des espaces où penser des stratégies collectives pour y faire face.
Les OSC ont dénoncé un manque de volonté politique face aux attaques des anti-droits, alors même que les mouvements féministes manquent cruellement de moyens financiers pour pouvoir travailler. Elles ont également dénoncé l’effacement insidieux des discours les plus progressistes dans les grandes conférences internationales, rappelant que les conférences sur les droits des femmes de Mexico, Nairobi et Pékin allaient beaucoup plus loin sur les questions d’intersectionnalité et de décolonialisme.
La CSW a aussi été l’occasion pour Equipop et ses partenaires du projet Walking the Talk de présenter lors d’un événement son Cadre commun de demandes pour le financement des mouvements féministes à des activistes du monde entier. Nous avons également profité de la présence à New York d’un grand nombre d’activistes féministes, de bailleurs et d’acteurs institutionnels pour organiser l’événement de lancement de l’Alliance féministe francophone, menée en consortium avec la FIDH et le FFMed. Nous avons facilité des rencontres entre les activistes partenaires de l’Alliance et le Ministère des Affaires étrangères ainsi que la délégation de parlementaires présente à New York, pour discuter de l’importance de financer l’égalité de genre et les organisations féministes, alors que la France a officiellement lancé sa stratégie “diplomatie féministe” quelques jours avant la CSW. Nous avons également rencontré la commissaire européenne à l’égalité Hadja Lhabib, au lendemain de la sortie de la feuille de route de l’Union européenne pour les droits des femmes.
Une mobilisation internationale pour des politiques étrangères féministes
Grâce au travail d’Equipop d’analyse et d’amendements du texte avec le consortium Countdown 2030 Europe, et aux échanges stratégiques avec la représentation permanente de la France aux Nations unies, Equipop a appuyé la France tout au long des négociations sur la déclaration politique. L’association est déterminée à poursuivre ce dialogue qui plus que jamais est essentiel, à l’approche de la Conférence sur le financement du développement de l’ONU et du Sommet pour les politiques étrangères féministes organisé par la France en 2025.
Dans sa prise de parole au nom du groupe d’Etats portant des politiques étrangères féministes, la France l’a rappelé : il faut continuer à défendre le multilatéralisme face aux voix conservatrices, mettre l’égalité de genre et les droits des femmes sur le devant de la scène internationale, et financer les organisations et mouvements féministes de manière substantielle face au backlash. La France doit tenir ces engagements au nom de sa diplomatie féministe. Pour cela, elle doit assurer une cohérence entre les discours portés sur la scène internationale et les politiques de financement portées par le gouvernement, et faire en sorte que les coupes drastiques de son APD n’aient pas de conséquences démesurées sur le financement des organisations féministes soutenues notamment par le mécanisme du FSOF. Nous continuerons à nous mobiliser en ce sens dans les prochains mois aux côtés des parlementaires français.
La CSW69 a soulevé un enjeu urgent : les responsables politiques doivent entendre les alertes des organisations féministes, et comprendre que les attaques contre les droits des femmes et l’égalité de genre vont de paire avec la montée de l’autoritarisme et du fascisme. Plus que jamais, il faut agir.