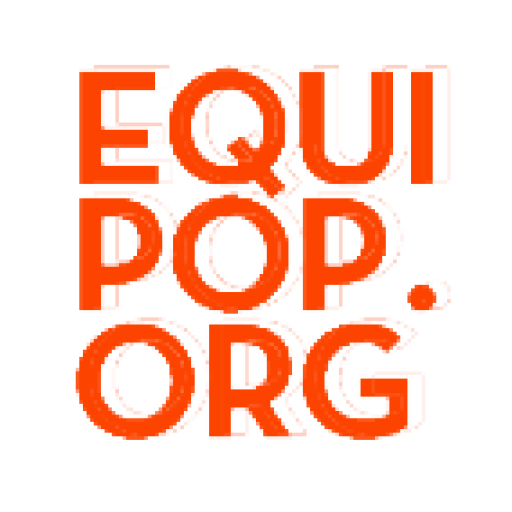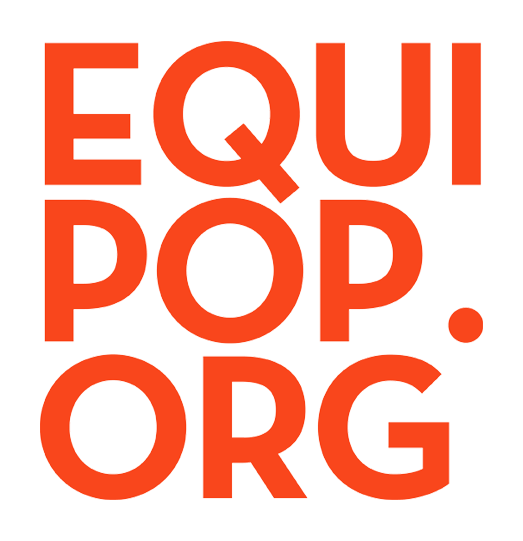L’Alliance Féministe Francophone à la CSW : Une présence forte et engagée
Quelques jours après le lancement de l’Alliance Féministe Francophone au Quai d’Orsay, un projet porté par Equipop, la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) et le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed), une première délégation de 17 activistes a participé à la 69e session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW) qui s’est tenue du 10 au 21 mars 2025 à New York, marquant le trentième anniversaire de la Déclaration et Plateforme d’Action de Pékin (Beijing+30).
L’Alliance Féministe Francophone (AFF) vise à renforcer la présence de féministes francophones dans les espaces multilatéraux, en offrant une perspective collective et diverse aux débats internationaux sur les droits humains et l’égalité de genre. Tel qu’explicité par Oumaima Dermoumi, Coordinatrice de l’AFF, ces activistes font face à de nombreux obstacles pour faire entendre leur voix – de la faiblesse des financements au manque d’accompagnement et de coordination jusqu’à la barrière linguistique, dans des espaces largement dominés par l’anglais et confrontés à une montée en puissance des mouvements anti-droits. L’Alliance se veut ainsi être un espace de plaidoyer, d’échange, de coordination et d’accompagnement dans un contexte de recul des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Comme l’explique Rachimini Malam Moumouni, Militante de la communauté des Négresses Féministes au Togo, leurs revendications se concentrent autour de cinq axes : 1) le financement des mouvements féministes, 2) la défense des droits acquis et la lutte contre les mouvements anti-droits, 3) l’accès aux droits et à la santé sexuels et reproductifs (DSSR), 4) la participation aux instances de décision et l’accès aux espaces publics et digitaux, et enfin, 5) la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Cette première délégation, dont plus de la moitié des membres participaient à la CSW pour la première fois, a permis de porter ces sujets clés lors de différents temps forts.
Renforcer les solidarités féministes internationales
Le 12 mars, la cérémonie de lancement de l’Alliance Féministe Francophone a rassemblé plus de 150 personnes aux profils divers : féministes, diplomates, représentants gouvernementaux, agences onusiennes, acteur.ice.s de la philanthropie et de la société civile. Ce moment festif et de sororité fut l’occasion de rappeler les enjeux de représentation et de financement des organisations féministes francophones sur la scène internationale, et d’ouvrir un espace de rencontre. Après une introduction de l’Alliance par sa coordinatrice, Oumaima Dermoumi, trois activistes sont intervenues. Hajer Naceur, Co-fondatrice et Coordinatrice du Front pour l’égalité et les droits des femmes (FEDF) de Tunisie, a souligné l’urgence de construire des ponts et de fédérer nos résistances. Sokhna Fall, Coordinatrice de l’Association Femmes Entraide & Autonomie a plaidé pour un soutien politique et financier accru pour soutenir les petites associations d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, faisant écho à l’appel de Oumou Khairy Diallo, Directrice Exécutive du Club Jeunes Filles de Guinée, pour davantage de solidarité et d’appui afin de briser le silence. Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire-Générale du Forum Génération Egalité auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, a quant à elle insisté sur la transversalisation de la perspective de genre dans la nouvelle stratégie internationale de la France pour une diplomatie féministe; Enfin, Julie Gonnet, Responsable adjointe de la division lien social de l’Agence Française de Développement, a souligné le puissant levier de changement que représentent ces voix féministes dans les espaces multilatéraux.
Faire émerger les réalités nationales des féministes francophones dans les espaces multilatéraux
Tout au long de la CSW, l’Alliance a participé à un vaste éventail d’évènements parallèles allant de la montée des mouvements anti-droits et du “backlash” (en particulier en matière de droits à la santé sexuelle et reproductive) à la lutte contre les violences basées sur le genre – via, par exemple, les cadres législatifs, la transformation des masculinités, la culture du consentement et l’engagement des jeunes – le financement des organisations féministes, l’intersection des agendas Femmes, Paix et Sécurité, l’action climatique et le désarmement. Plusieurs membres de l’Alliance ont délivré des interventions puissantes, à l’instar de Carelle Laetitia Goli, Activiste féministe de Côte d’Ivoire, juriste et blogueuse, invitée comme panéliste dans l’évènement “Femicide: A Global Crisis – A Conversation with Women Activists from Haiti, Kenya, and Ivory Coast”. Elle a mis en lumière le besoin de nommer les violences sexistes et sexuelles et les féminicides, de renforcer les cadres législatifs et de prendre en considération les effets négatifs sur les victimes secondaires, notamment les enfants et les membres de famille. Oumou Khaïry Diallo, Directrice Exécutive du Club Jeunes Filles de Guinée, est intervenue lors de l’événement “Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage” (organisé par Girls First Fund, Nawi, UK FCDO, et Global Affairs Canada) pour alerter sur les limites des services de protection et de prise en charge des cas de mariages précoces en Guinée, la persistance de la culture patriarcale comme accélérateur de cette pratique néfaste, et les manques de financements pour les organisations féministes.
Faire mouvement pour promouvoir l’égalité
Pensée comme un espace d’échanges et de rencontres, l’Alliance a également organisé des rencontres bilatérales en amont et durant la CSW avec des acteurs clés de l’écosystème multilatéral. En amont de la CSW, les activistes ont échangé avec les eurodéputées Mélissa Camara (France) et Hannah Gedin (Suède), en vue de présenter la mission de l’Alliance et d’ouvrir un dialogue sur des pistes de collaboration à l’échelle de l’Union Européenne. Ces discussions se sont poursuivies à New York avec la délégation parlementaire française, avec la Commissaire européenne à l’égalité Hadja Lahbib, des acteurs philanthropiques, comme la Fondation Chanel ou la Foundation for a Just Society, et des institutions onusiennes, telles que ONU Femmes et ONUSIDA. De nombreux échanges avec les acteur.ice.s de la société civile féministe ont par ailleurs eu lieu tout au long de la CSW, afin de renforcer les partenariats stratégiques. Comme souligné par Oumou Khaïry Diallo, ces rencontres bilatérales ont présenté des opportunités cruciales pour ancrer les débats multilatéraux dans les réalités nationales, renforcer les solidarités entre acteurs, et insister sur la nécessité d’aligner les soutiens politiques témoignés aux organisations féministes et les diplomaties féministes à des financements adéquats, notamment via l’aide publique au développement (APD). En marge de la CSW, certains membres de l’Alliance ont également participé à la marche “No Backlash to Women’s Rights” pour exiger des droits égaux pour toutes les femmes et manifester contre les inégalités persistantes et les discriminations multiples.
Lutter contre les régressions politiques et les mouvements anti-droits
Bien que la participation de l’Alliance Féministe Francophone à la 69e session de la CSW (2025) soit un pas important, il ne faut pas négliger les défis persistants. En dépit de certains progrès, le contexte global des droits des femmes semble stagner – voire régresser.
Cette tendance a été rappelée lors de l’évènement parallèle organisé par la FIDH et l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), portant sur le recul des droits des femmes dans le Maghreb, réunissant des militantes de Tunisie, du Maroc et d’Algérie. Les discussions, modérées par Mouna Dachri, Chargée de mission au bureau Maghreb et Moyen-Orient de la FIDH, ont mis en lumière l’impact des alliances entre régimes autoritaires et groupes conservateurs, ainsi que les stratégies de résistance féministe face à ces menaces croissantes. De même, plusieurs activistes ont pu se joindre à des rencontres avec des ONG féministes dans le monde arabe, pour faire état de régressions qui touchent particulièrement les femmes et de restrictions portées à la liberté d’association, en appelant à renforcer leurs solidarités pour permettre de continuer à mener leurs activités à bien.
De même, tel que l’a noté Najet Araari, Sociologue féministe tunisienne, à l’occasion de l’adoption par consensus de la Déclaration Politique Beijing+30, si l’inclusion de la lutte contre les VSS et du soutien aux organisations de défense des droits des femmes dans le texte est notable, l’omission – préoccupante – des droits sexuels et reproductifs a aussi été notée. La question de la montée en puissance des mouvements anti-droits, qui visent à restreindre les libertés acquises et à limiter l’accès aux droits fondamentaux des femmes, suscite beaucoup d’inquiétudes, et rend encore plus urgente la nécessité de maintenir la pression pour un véritable changement.