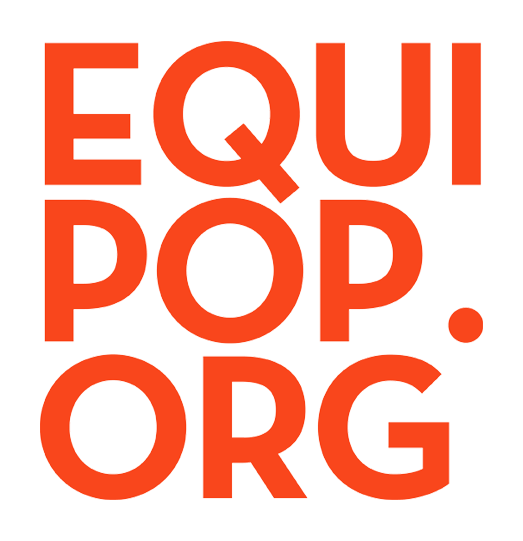– Lutter contre les violences faites aux femmes #4 : Au Sénégal, avec Néné Maricou
Tout au long des 16 jours d’activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes, Equipop interviewe ses partenaires sur leurs actions de lutte contre les violences basées sur le genre.
L’activiste Néné Fatou Maricou est présidente du réseau Youth Woman for Action (YWA), un mouvement national de filles et jeunes femmes leaders du Sénégal.
Pouvez-vous nous rappeler l’actualité de la lutte contre les violences basées sur le genre au Sénégal ?
Ces trois dernières années, de nombreux cas de violences, ont été dénoncés. Je ne parle pas de chiffres, mais d’un constat général. Avant, on ne voyait pas tout ce ui se passait. Mais à travers les réseaux sociaux, beaucoup de cas ont été notifiés. Des médias ont même relayé ceux que nous avons portés sur la place.
Jusqu’alors, chaque organisation déroulait ses activités, nous faisions des actions pour dénoncer, mais sans nous organiser. Il y a eu un virage courant 2019, suite à une tentative de viol qui a mené à la mort d’une de nos sœurs : Bineta Camara. Un mouvement de revendication est né : le collectif, Dafadoye (Ça suffit ! »). Il a été créé par des activistes, dont l’Association des Femmes juristes était le noyau. Nous avons été intégrées dès le début. Puis de nombreux groupes sont entrés dans la mouvance. Avec Dafadoye, les organisations de la société civile ont porté ce combat ensemble. Les gens ont fait des sorties, puis ont saisi l’Assemblée nationale et interpellé la présidence de la République.
Avec mon association, par exemple, nous avons fait une pétition en ligne pour demander au Président de criminaliser le viol. En une semaine, nous avons recueilli plus de 1000 signatures. Par la suite, en janvier 2020, nous avons obtenu une loi qui pénalise le viol et la pédophilie au Sénégal. Avant, ça n’était tout simplement pas des crimes !
Il y a encore à faire sur les questions de mariage d’enfants. Le problème est que l’âge légal au Sénégal est actuellement de 16 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Nous essayons de voir pour que le gouvernement révise le code de la famille et relève l’âge légal à 18 ans.
Il faut aussi évoquer les mutilations sexuelles féminines qui restent très ancrées au Sénégal. Dans les régions de Kolda, la prévalence est de 94 % de filles et femmes excisées et 93% pour Maatam ou encore 86 % dans la région de Tambakounda. Aujourd’hui, on sait que ce sont des violations flagrantes des droits avec des conséquences néfastes très graves sur la santé sexuelle et reproductive. Pourtant, nous avons une loi depuis le 25 janvier 1999, qui sanctionne l’acte de mutilation génitale féminine. Malheureusement, très peu de cas ont été remontés. Les sanctions ne sont pas appliquées. Si l’application de la loi n’est pas mise en œuvre, les personnes qui pratiquent ces violences vont les perpétuer.
Est-ce que ces mobilisations peuvent faire bouger les lignes ?
Cette année, pour le lancement des 16 jours d’activisme, une campagne de promotion et de vulgarisation de la loi de 2019 a été lancée. Nous espérons vraiment qu’il y aura une mise en œuvre. Et surtout que les jeunes seront au cœur de cette campagne de vulgarisation.
Si je prends le travail de mon organisation, YWA, nous faisons des efforts pour communiquer sur tous les types de violences basées sur le genre. Nous faisons des interventions dans les régions pour sensibiliser la population sur les pratiques socioculturelles néfastes.
Il y a un point important pour avancer réellement, c’est que les personnes comprennent bien ce que sont les VBG.
Vous croyez que cela permettrait de changer en profondeur la société sénégalaise ?
« Corriger sa femme », « harceler », « les attouchements »… les gens ne comprennent pas toujours ces mots. Il faut travailler à faire prendre conscience de ce que sont les VBG. Nous prévoyons des actions de plaidoyer et des campagnes de prévention contre les actions néfastes auprès des jeunes et des parents. Le système scolaire aussi a une très grosse responsabilité : celle d’enseigner aux jeunes ce que sont les VBG pour que les jeunes soient en mesure de prendre leurs responsabilités.
Pour certains cas de VBG ou de viol, les gens ont des difficultés à parler, à faire remonter leurs cas, sous peur d’être indexés ou stigmatisés. Aujourd’hui, les filles ne doivent plus avoir peur. Elles doivent dénoncer, se rendre dans les services de prise en charge : aller voir un médecin, aller à la police… Il faut aussi renforcer l’accompagnement psychologique des victimes. Une fille qui a une grossesse après un viol peut penser à se détacher de la grossesse, même à se suicider. Il y a déjà les boutiques de droits de l’AJS qui font un très gros travail. Mais nous voulons davantage de structures pour prendre en charge les victimes.