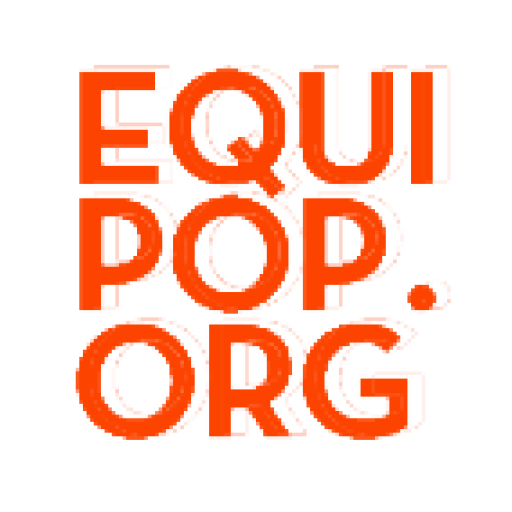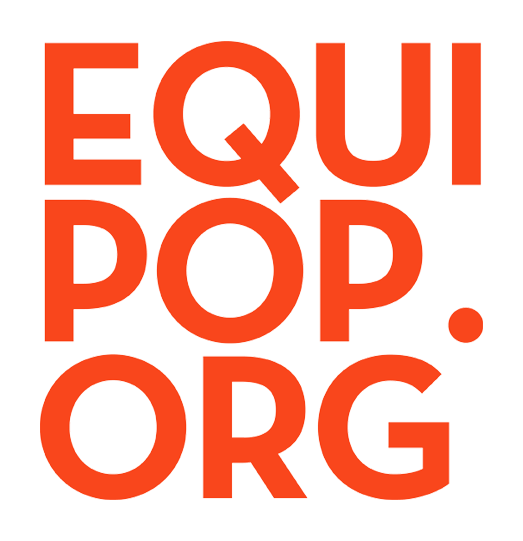– À LA CPD58, NE PAS LAISSER LE CHAMP LIBRE : PRÉSENCE FÉMINISTE, ET VIGILANCE.
CE QUE NOUS APPREND NOTRE PARTICIPATION À LA 58E SESSION DE LA COMMISSION SUR LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT
Du 7 au 11 avril 2025, Equipop a pris part à la 58e session de la Commission des Nations unies sur la population et le développement (CPD). Le thème de cette année : « Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous et toutes, à tout âge ». Un espace dense, institutionnel, largement dominé par les États… et pourtant un espace plus qu’essentiel et central pour défendre les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR) comme piliers et leviers d’égalité.
La Commission des Nations Unies sur la Population et le Développement (CPD) est chargée de suivre la mise en œuvre du Programme d’action adopté lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994, au Caire (Egypte). Ce programme a marqué un tournant en plaçant la dignité humaine et les droits, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, au cœur des politiques de développement durable. La CPD évalue chaque année les avancées et oriente les politiques à travers des résolutions.
Il y a un mois, nous étions à la 69e session de la Commission sur le statut des femmes des Nations Unies (CSW69) avec l’Alliance Féministe Francophone. Cette fois, c’était la CPD : un espace plus discret, plus technique mais tout aussi stratégique. Moins de side events, moins de militant·es, plus de technocrates et de diplomates. Les discussions s’y déroulent souvent à huit clos, et chaque mot fait l’objet d’âpres négociations. Si l’énergie y semble moins palpable qu’à la CSW, l’enjeu lui, reste de taille : faire évoluer le consensus autour des DSSR dans un contexte mondial de durcissement idéologique.
Dans ce contexte, une question centrale se pose : comment la société civile et les féministes peuvent-elles continuer à y peser ?
QUAND LES DROITS NE FONT PLUS CONSENSUS : LA BATAILLE DES DSSR À LA CPD58
Dès l’ouverture, l’intervention de Dr. Natalia Kanem, directrice exécutive du FNUAP, a posé le cadre : réaffirmer l’héritage de la CIPD et replacer les DSSR au centre de l’agenda mondial. Un appel nécessaire, dans un contexte multilatéral fragilisé, où les droits sexuels et reproductifs reculent sous pression, comme en témoigne l’effacement total de ces droits dans la déclaration finale de la CSW69.
La CPD58 incarnait ainsi l’un des rares espaces institutionnels capables de porter ces enjeux à l’agenda. Mais les négociations et les prises de paroles en plénières ont rapidement mis en évidence les tensions structurelles qui traversent le système onusien, révélant un multilatéralisme de plus en plus polarisé et un consensus international en net recul.
D’un côté, des prises de position fortes et inattendues : dès le premier jour, la Sierra Leone au nom de 78 pays, a défendu une déclaration ambitieuse et englobante des DSSR. Un texte qui relie la santé aux inégalités systémiques (sociales, économiques, raciales, de genre) et qui affirme clairement que dignité, choix et justice sociale ne peuvent être dissociés de la transformation des structures de pouvoir. Une parole rare, qui a résonné bien au-delà de la salle de conférence. La Norvège a elle aussi réaffirmé sa position historique en faveur de l’égalité de genre, en soulignant les reculs préoccupants observés dans de nombreux pays.
Mais ces prises de position se sont heurtées à une offensive organisée. Les États-Unis, dans la continuité de leur posture lors de la CSW69, ont adopté une ligne de rupture assumée : rejet explicite de l’Agenda 2030, désengagement vis-à-vis des objectifs de développement durable (ODD), repli sur une vision traditionaliste de la famille, promotion de la Déclaration de Genève, un outil idéologique mobilisé pour remettre en cause les droits reproductifs, notamment l’avortement. L’Argentine, l’Iran et quelques autres États ont soutenu cette dynamique, révélant une tentative concertée de redéfinir les normes multilatérales sur des bases réactionnaires, au mépris des réalités vécues par des millions de personnes à travers le monde. Plus que des prises de parole isolées, ces interventions s’inscrivent dans une offensive globale visant à délégitimer les droits reproductifs, et à réinstaller des normes patriarcales au cœur des institutions internationales.
Dans ce contexte tendu, des résistances se sont organisées. L’Afrique du Sud, appuyée par 42 pays de toutes les régions, a exprimé une vive inquiétude face aux tentatives répétées de remise en cause de droits ayant bénéficié d’un consensus de longue date, qui ont été en jeu pendant les négociations de cette CPD. Le pays a rappelé l’urgence de protéger les acquis historiques du programme d’action de la CIPD, de défendre le multilatéralisme et de réaffirmer les engagements envers l’Agenda 2030, y compris les ODD dans leur intégralité. L’Uruguay ou encore le Paraguay ont également pris la parole pour dénoncer l’absence de consensus, tout en réaffirmant leur attachement aux principes fondateurs de la CIPD.
Ce moment illustre un paradoxe devenu structurel : une majorité d’États mobilisés pour défendre les droits, mais dont les efforts se heurtent à la capacité d’obstruction d’une minorité puissante diplomatiquement. La bataille pour les DSSR ne se joue plus seulement sur le fond, mais sur les mécanismes mêmes de la gouvernance internationale.
Depuis dix ans, l’adoption d’une résolution à l’issue des sessions de la CPD tend à devenir l’exception plutôt que la règle. C’est le signe d’un blocage politique croissant autour des droits et de la santé sexuels et reproductifs, mais aussi d’un affaiblissement de la portée normative de cet espace. En 2025 encore, les divisions entre États progressistes et anti-droits ont empêché toute avancée conclusive. La 58e session s’est donc terminée sans texte, une fois de plus.
UN ESPACE STRATÉGIQUE, MAIS PEU INVESTI PAR LES FÉMINISTES
Dans cet espace, les voix féministes, en particulier celles d’Afrique de l’Ouest et du monde francophone, sont peu présentes. Ce manque de représentation a des conséquences concrètes : les perspectives portées à partir de nos réalités sont peu visibles, et nos priorités rarement défendues.
Cela nous oblige à une réflexion stratégique : comment continuer à peser dans un espace où les résultats officiels sont gelés, mais où se rejouent des rapports de force cruciaux pour nos droits ?
Ce que cette session a montré, c’est que sans action collective ni coordination, l’influence reste limitée. Certaines coalitions dans lesquelles nous avons été impliquées comme International Sexual and Reproductive Rights Coalition (ISRRC) ont joué un rôle structurant. Elles décryptent les formulations des textes onusiens, proposent des alternatives, et facilitent la transmission de messages clairs auprès des délégations. Sans ancrage dans ces dynamiques, même une présence sur place ne suffit pas.
Les voix de la société civile se sont fait entendre, ponctuellement, dans les plénières. Mais leur absence totale dans la plénière d’ouverture reste symptomatique d’un déséquilibre persistant. Dans cet espace très institutionnalisé, les voix des activistes et des mouvements féministes doivent pouvoir se faire entendre plus que jamais pour contrebalancer les discours purement étatiques, mais aussi pour faire exister d’autres récits. Ceux qui partent des réalités vécues, des pratiques de terrain, et des approches politiques portées par la société civile.
La CPD, contrairement à la CSW, reste peu investie par les événements parallèles, alors qu’ils jouent souvent un rôle de rééquilibrage dans les débats. Et quand ils ont lieu, certains sont captés par les mouvements anti-droits. L’un d’eux est même allé jusqu’à qualifier de fake news les argumentaires de la déclaration portée par la Sierra Leone. Un exemple de leur capacité d’organisation et de leur stratégie de discrédit.
D’autres espaces auxquels nous avons participé ont cependant permis de porter des voix puissantes. Des organisations militantes y ont défendu des messages clairs sur la mortalité maternelle, la santé et la dignité menstruelle, ou encore les soins autogérés et communautaires. Toutes ont placé au cœur des échanges les savoirs, les vécus, et les actions portées par des actrices en lien direct avec leurs contextes.
UNE CHOSE EST CLAIRE : ON NE PEUT PLUS RESTER EN MARGE
Bien que la CPD ne soit pas l’espace le plus visible, ni le plus accessible, elle reste un espace stratégique, dans lequel les engagements internationaux concernant les DSSR sont redéfinis, se révisent, parfois pour le meilleur, souvent sous pression. S’y rendre est donc important. Y aller préparé·es, ensemble, avec une stratégie partagée, l’est encore plus.
Equipop continuera à y faire entendre les voix de ses partenaires, à défendre une lecture féministe des politiques de droits et de santé sexuels et reproductifs, et à œuvrer pour que nos récits, ceux du choix, de la justice, de la dignité, soient entendus là où se décident les normes qui impactent nos vies.