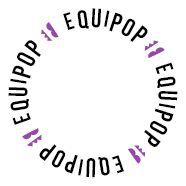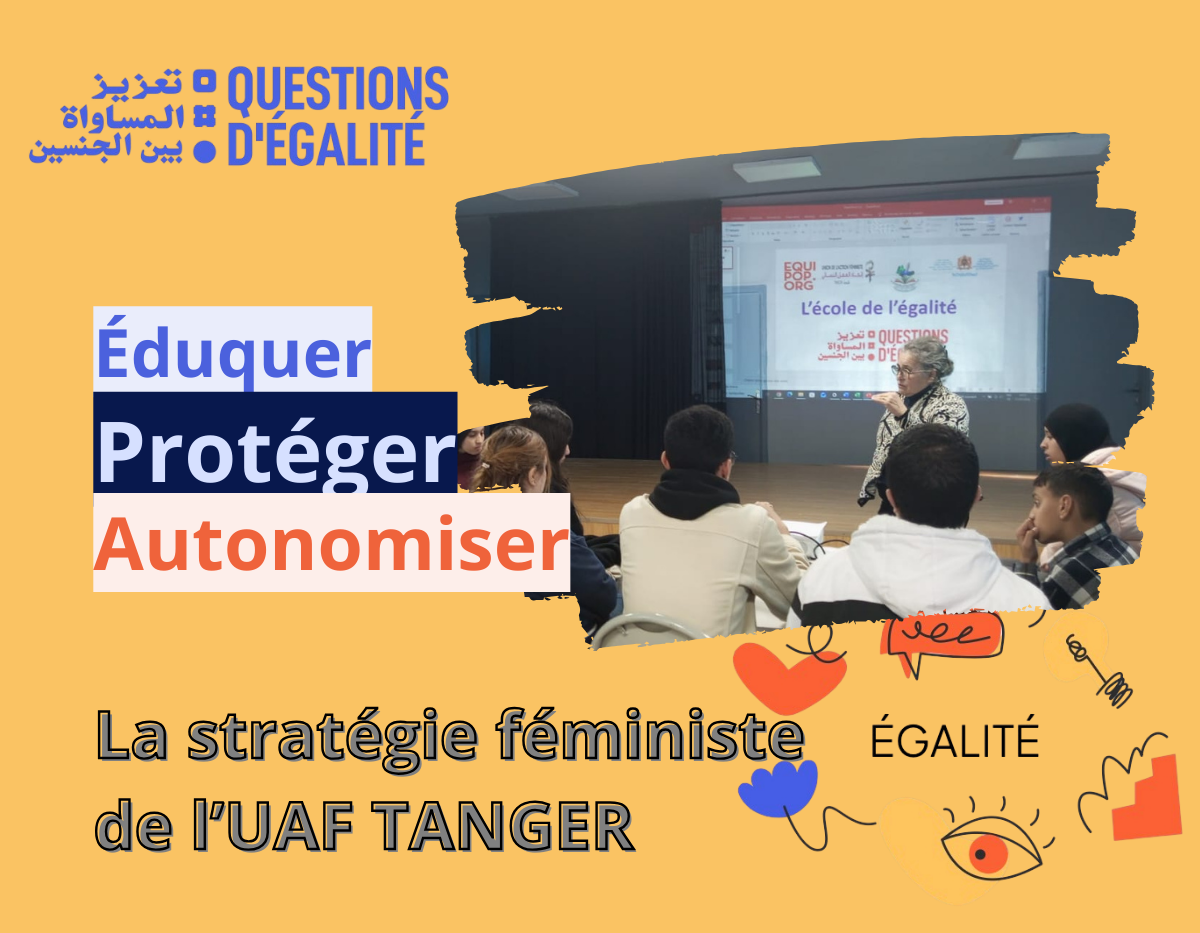Du 4 au 6 mars 2024 à Cotonou, Equipop a organisé, avec un comité d’expertes, un symposium intitulé « Un espace à nous entre militantisme et recherche : dialoguons sur une approche féministe des DSSR ! ».
Financé par AMC dans le cadre du projet Foundation, cet événement a rassemblé 40 militant·e·s et chercheur·e·s de 14 pays différents pour réfléchir collectivement à repolitiser les enjeux liés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (DSSR) dans une perspective féministe ainsi qu’aux actions pour lutter contre les mouvements anti-droits.
Faire mouvement en pensant collectivement les enjeux liés aux DSSR et les actions pour les défendre
Les DSSR sont des droits fondamentaux qui reposent sur des droits humains reconnus de longue date. Les DSSR relèvent également d’enjeux politiques ; les problèmes auxquels ils répondent (mortalité maternelle, infections sexuelles transmissibles, grossesses non désirées, accès à la dignité menstruelle, violences sexuelles et sexistes, etc.) sont à envisager comme résultant de rapports de pouvoir et de richesse, ainsi que de choix de méthodes et de priorités politiques. Une des questions qui revient en boucle dans les espaces féministes à travers le monde est : à qui appartient le corps des femmes ? “Nous sommes des corps chargés d’histoire. En 2017, Macron peut, au cours d’une rencontre internationale en Allemagne, décider de parler de la maternité des femmes africaines sans que cela choque outre mesure, et dans le même temps, en 2024, parler de réarmement démographique dans un contexte français. […] On ne peut pas penser qu’on n’est que des corps de femmes. […] Quand Awa Thiam dit « La parole aux négresses », elle dit qu’il faut nous entendre en tant que sujet, en tant que nous. Et dans l’intime, on est rattrapé par ça. Quand on politise qui nous sommes, on comprend que nous sommes des projets au-dessus de nous.” Odome Angone De nombreuses avancées en matière de DSSR ont été obtenues par nos aînées depuis des décennies, et il reste important de renouveler nos réflexions et mobilisations sur la question pour 3 raisons principales :- Les positionnements sur les DSSR restent trop souvent ancrés dans une approche biomédicale, santé publique voire instrumentale au service de la croissance, laissant de côté la question du choix et des droits des personnes. A Lire l’article sur le réarmement démographique
- Les DSSR ne sont pleinement garantis sur aucun territoire. Ils sont très régulièrement remis en cause, attaqués, que ce soit dans des contextes nationaux ou dans des négociations internationales sur l’égalité de genre. A lire le rapport publié par Equipop et la Fondation Jean Jaurès en 2023.
- Enfin, il est important de prolonger l’élan des nouvelles mobilisations féministes post #Metoo qui concernent tous les continents.
Façonner un “espace à nous”, entre militantisme et recherche
Avec l’appui d’un comité d’expertes et des études exploratoires, l’ambition de ce 1er symposium consistait à faire dialoguer les milieux académiques et militants féministes francophones d’Afrique de l’Ouest, Afrique du Nord et Europe, pour se créer un “espace à nous” autour d’une question simple : selon vous, qu’est-ce qu’une approche féministe des DSSR ? Pour y répondre, 40 militant·e·s et chercheur·e·s féministes de 14 pays différents (Belgique, Bénin, Burkina Faso, Canada, Côte d’Ivoire, France, Italie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Pays-Bas, Sénégal, Tunisie) se sont rassemblé·e·s à Cotonou les 4, 5 et 6 mars 2024 pour discuter des enjeux suivants :- Savoir pour agir : l’éducation complète à la sexualité au prisme du cycle de vie ;
- Des cercles de paroles au manuel de libération des femmes : regards croisés sur la valorisation des savoirs expérientiels ;
- Notre corps, notre choix, notre droit : autonomie corporelle et justice reproductive ;
- Violences gynécologiques et obstétricales et inégalités de santé ;
- A l’intersection des oppressions : comment défendre l’accès de tous·tes aux DSSR face aux mouvements anti-droits, dans des contextes hostiles ?
- La projection du documentaire “We are coming”, chronique d’une révolution féministe et d’un échange avec Nina Faure, la réalisatrice ;
- Une séquence d’art thérapie avec Salimata Kaboré, artiste peintre.