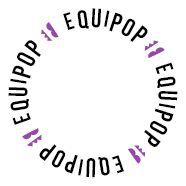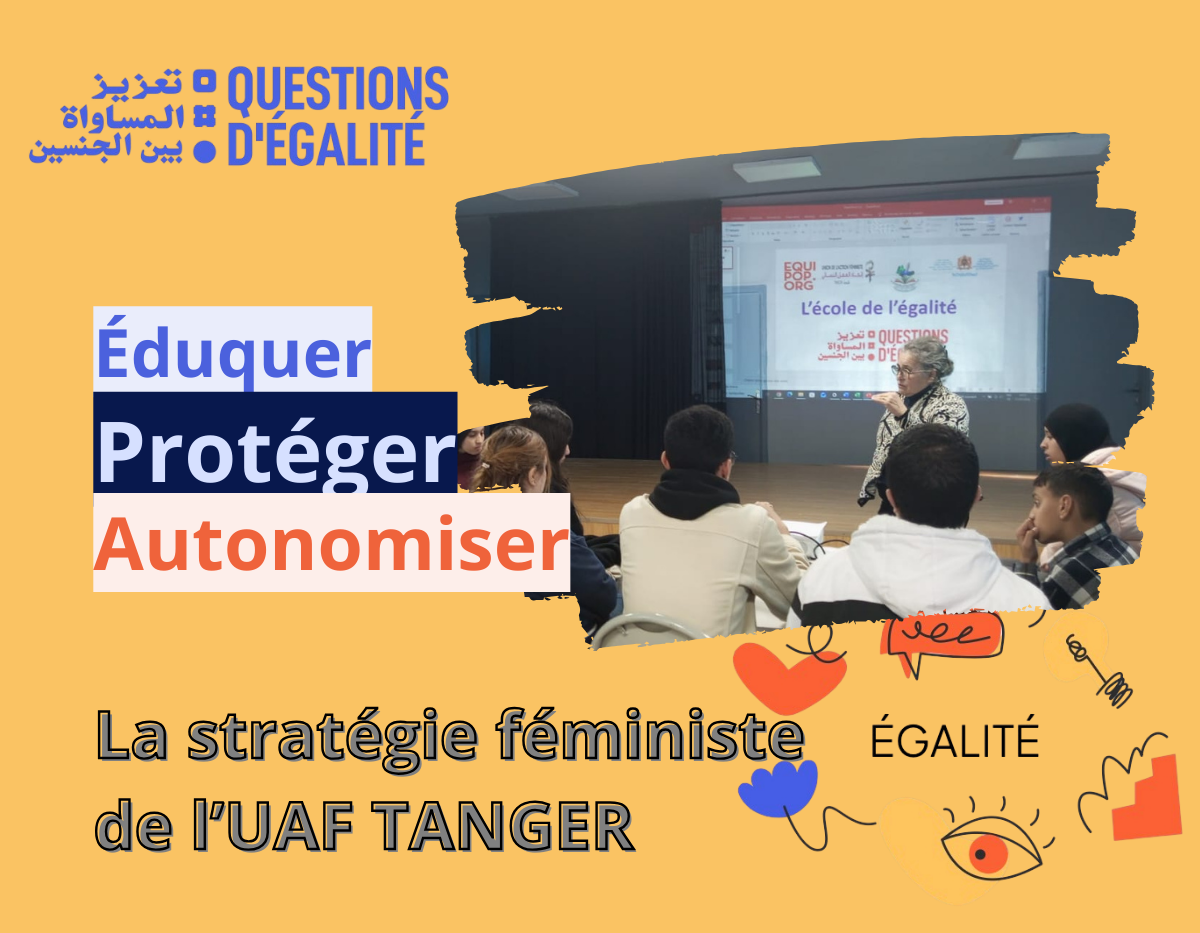Backlash contre les droits des femmes et personnes LGBTQIA+, montée des extrêmes droites, désinformation climatique, attaques contre la solidarité internationale : dans ce contexte, les médias ne sont pas de simples témoins, ils sont au cœur d’une véritable « bataille du récit ».
C’est à partir de ce constat qu’Equipop, Prenons La Une et La Fronde ont conçu ensemble un magazine de 60 pages, pensé comme un outil à destination des journalistes et des écoles de journalisme :
Journalistes & Féministes :
Mieux informer pour préserver la démocratie

Cette publication propose à la fois un décryptage international des stratégies réactionnaires, des récits de terrain de journalistes et d’associations, et des recommandations concrètes pour transformer les pratiques médiatiques.
Une alliance inédite entre journalistes et féministes
Ce magazine est le fruit d’une collaboration inédite entre une association féministe de solidarité internationale (Equipop), une association de journalistes engagées pour l’égalité dans les médias (Prenons La Une) et une agence de formation féministe (La Fronde).
Le projet est né d’une journée organisée au CESE en février 2025, “Femmes & Médias – Les Rencontres de l’Égalité”, qui a réuni début 2025, journalistes, chercheuses et militantes autour d’une question simple : comment faire face, ensemble, à la montée des extrêmes droites et à l’offensive contre les droits des femmes, la liberté de la presse et la solidarité internationale ?
Le magazine repose sur une conviction forte, qui traverse l’ensemble des textes : journalistes et féministes partagent les mêmes adversaires, et une responsabilité commune dans la défense de la démocratie.
Décrypter le backlash et les stratégies réactionnaires
La première partie du magazine s’attache à décrypter l’offensive réactionnaire mondiale. On y retrouve, par exemple, un entretien avec l’organisation féministe AWID autour de la campagne #FreezeFascisms, qui montre comment les mouvements fascistes et fondamentalistes s’attaquent aux droits des femmes, à la justice de genre et au système multilatéral.
D’autres textes analysent le recul de la liberté de la presse en Hongrie, sous Viktor Orbán, et en Italie, sous Giorgia Meloni, où la mainmise sur les médias publics et privés va de pair avec un durcissement des politiques anti-droits. Aux États-Unis, le deuxième mandat de Donald Trump est présenté comme un cas d’école : attaques contre les médias, “bulldozer” de désinformation, suppression de contenus publics, démantèlement de l’aide au développement.
Le magazine met aussi en lumière le rôle des Big Tech dans la diffusion des discours masculinistes, racistes et antiféministes, et la façon dont la crise de l’aide publique au développement touche en priorité les droits des femmes et les organisations féministes.
Antiféminisme médiatique, fémonationalisme et banalisation de l’extrême droite
Une autre partie du magazine explore les mécanismes de l’antiféminisme médiatique. Elle montre comment l’extrême droite travaille son image pour séduire une partie de la jeunesse et se rendre socialement acceptable.
Les textes analysent également l’infiltration des mots du racisme dans le débat médiatique (“grand remplacement”, “ensauvagement”, “wokisme”, “guerre culturelle”…), repris parfois sans recul critique. Un chapitre est consacré au fémonationalisme, cette instrumentalisation des droits des femmes à des fins xénophobes et anti-immigration, notamment dans les campagnes électorales européennes et françaises.
Le magazine interroge aussi les pratiques journalistiques elles-mêmes : fascination pour certaines figures de l’extrême droite, portraits complaisants, manque de journalistes spécialisés sur ces questions alors même que les extrêmes droites gagnent du terrain.
Voix de terrain et pratiques de résistance

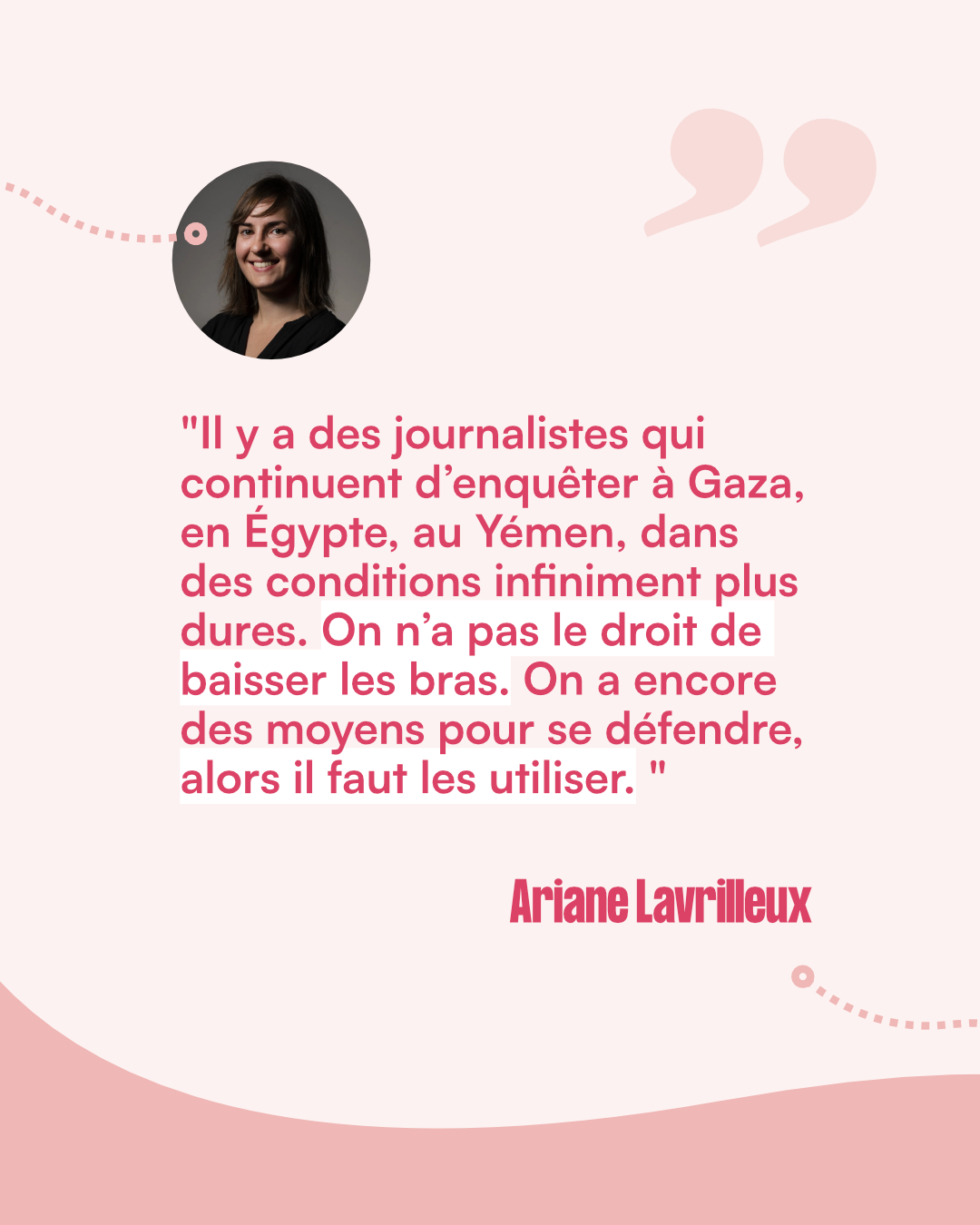
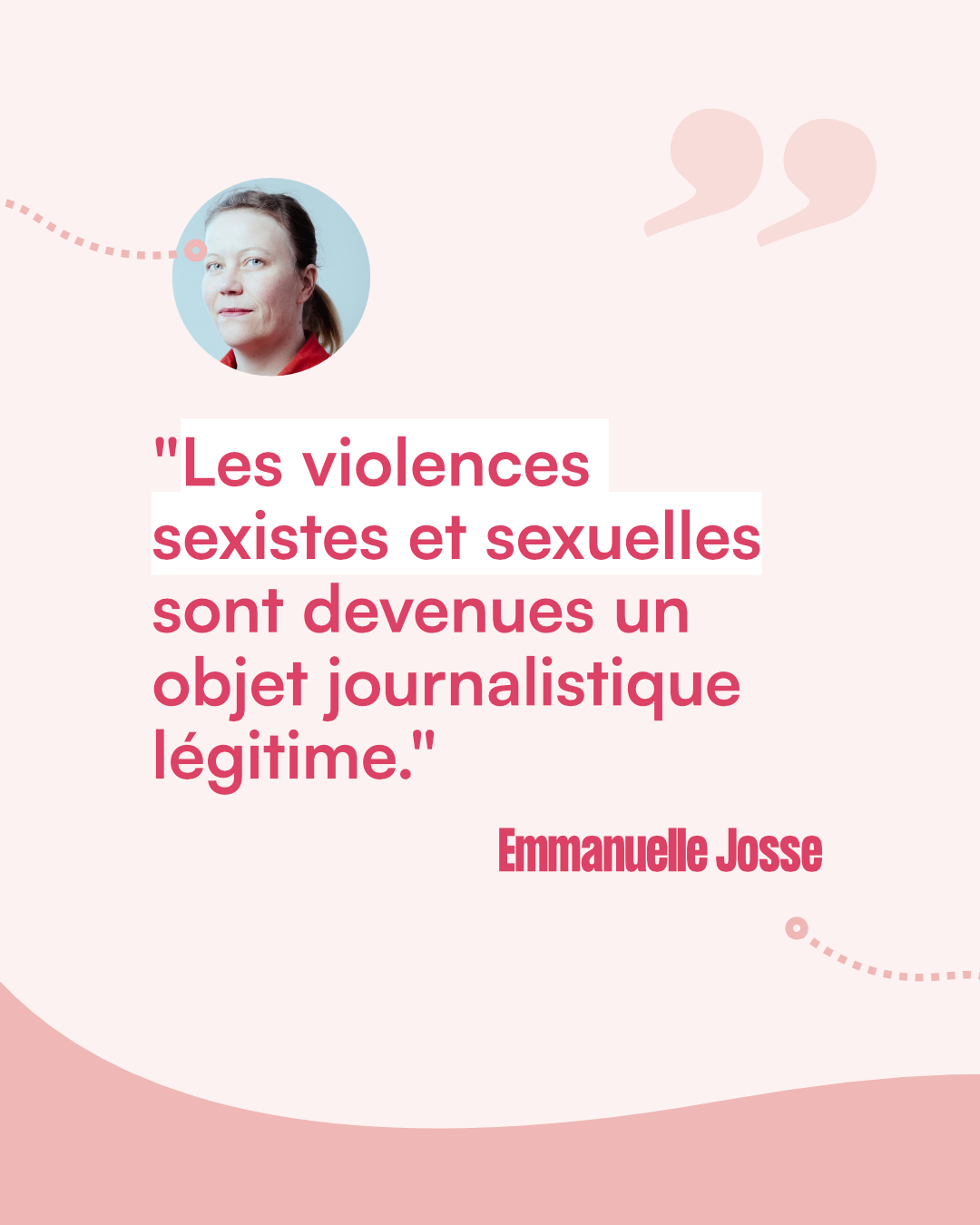
Tout au long de la publication, des journalistes, collectifs et médias indépendants partagent leurs expériences :
- Salomé Saqué démonte le mythe de la “neutralité journalistique”, souvent brandi pour disqualifier les sujets féministes, antiracistes ou écologistes.
- Ariane Lavrilleux raconte les conséquences de la surveillance et des procédures judiciaires contre les journalistes d’investigation.
- Coline Folliot (AJL) analyse la transphobie médiatique et rappelle l’importance de nommer précisément les réalités.
- Estelle Ndjandjo (AJAR) décrit le déni du racisme dans les rédactions françaises et plaide pour parler de racisme structurel plutôt que de simples “stéréotypes”.
- Emmanuelle Josse, co-fondatrice de La Déferlante témoigne de ce que signifie faire vivre un média féministe indépendant aujourd’hui.
- Francesca Festa, co-fondatrice du réseau Sphera montre comment des médias indépendants européens s’organisent collectivement pour résister aux pressions politiques et économiques.
Des exemples concrets de résistance collective complètent ces récits : mobilisation des journalistes du groupe Bayard face à l’ultraconservatisme, cordon sanitaire médiatique en Belgique francophone, rôle pionnier de la télévision publique espagnole sur l’égalité, initiatives comme Quota Climat pour documenter la désinformation climatique.
Des recommandations concrètes pour rédactions et écoles de journalisme
Le magazine ne se limite pas au constat. Il se termine par des recommandations opérationnelles destinées aux rédactions et aux écoles de journalisme. Elles portent notamment sur :
- la formation continue aux enjeux de genre, de racisme, de classe et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ;
- la création de postes de gender-editors et de race-editors, véritables vigies internes pour les contenus ;
- la protection des journalistes face au cyberharcèlement ;
- un traitement rigoureux des extrêmes droites ;
- le soutien et le financement d’une presse libre, indépendante et féministe.
Ce magazine a été pensé pour nourrir des articles, des reportages, mais aussi des conférences de rédaction, des cours en écoles de journalisme ou des temps d’échanges internes.
_ _ _ _ _
Une publication qui vient s’ajouter au Centre de Ressources d’Equipop.