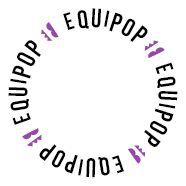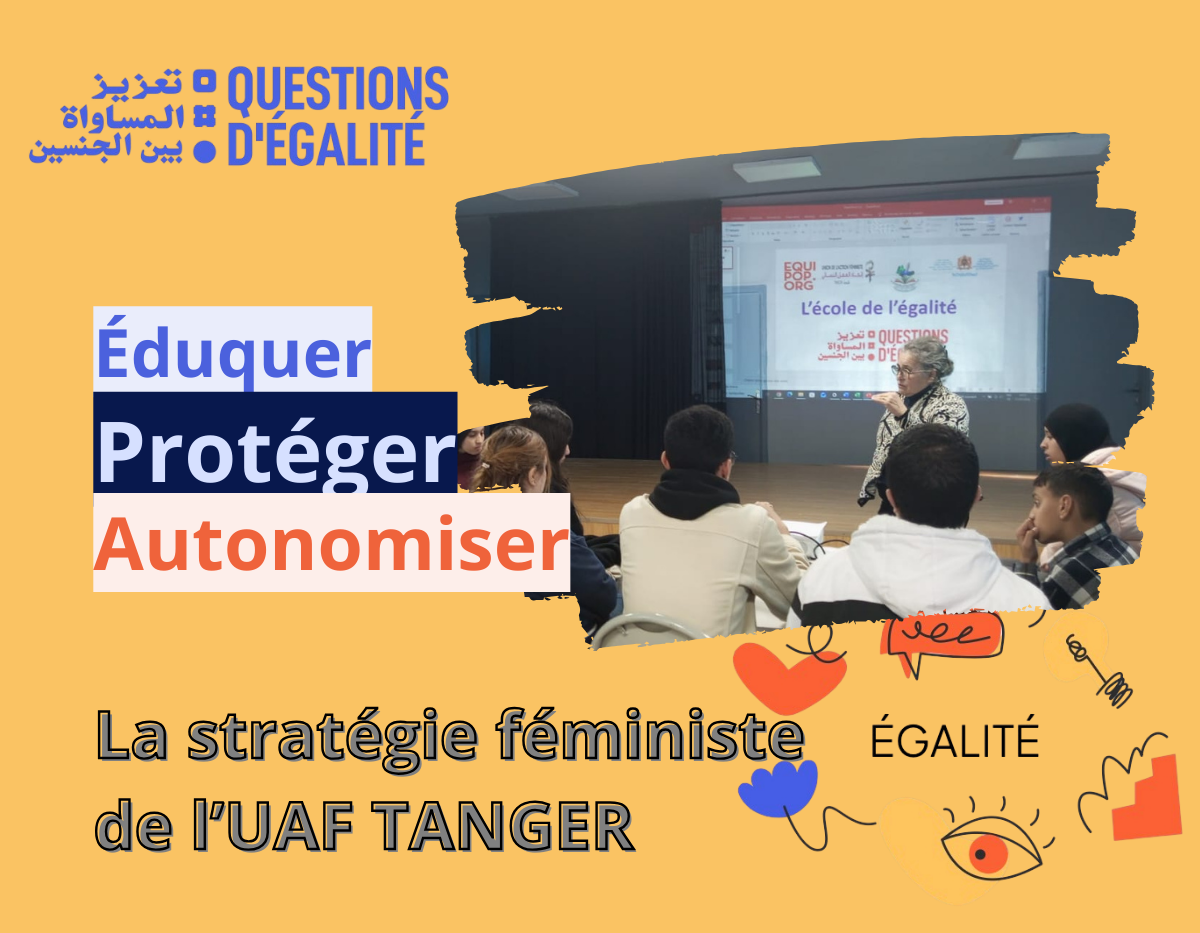Dans un contexte de recul des droits et de crise des financements, la Conférence ministérielle sur les diplomaties féministes a réuni 31 États à Paris. Les activistes féministes qui ont marqué l’événement décryptent les annonces officielles et en rappelant l’urgence d’une diplomatie réellement transformatrice, construite avec les actrices de terrain, et non simplement proclamée.
La diplomatie féministe au cœur des enjeux mondiaux
Le concept de politiques étrangères féministes (PEF) émerge dans les années 2010 avec la Suède de Margöt Wallström, première à adopter officiellement une diplomatie féministe fondée sur les « trois R » — Rights, Resources, Representation. Inspirée par cette approche, une douzaine de pays dont la France, le Canada, le Mexique, l’Espagne ou encore le Chili se sont engagés sur cette voie. Mais alors que certains États reculent, comme la Suède ou les Pays-Bas après des changements politiques majeurs, la quatrième Conférence ministérielle des diplomaties féministes, organisée à Paris les 22 et 23 octobre 2025, a marqué un moment clé pour consolider les engagements internationaux en faveur de l’égalité de genre. Cet engagement s’est concrétisée par l’adoption d’une Déclaration Politique ambitieuse par 31 États1, qui comporte notamment plusieurs appels à action. Respect des droits fondamentaux et de lutte contre les violences basées sur le genre, soutien à la société civile féministe, droits et santé sexuels et reproductifs, participation des femmes et renforcement de la mobilisation dans la sphère multilatérale. Ces enjeux transversaux sont portés depuis longue date par la société civile féministe, et s’inscrivent au coeur du plaidoyer collectif porté par l’Alliance Féministe Francophone.
Une édition 2025 cruciale pour les droits des femmes, sous le signe du backlash et d’un contexte de polycrise mondial
Rassemblant plus de 400 participant·e·s — représentant·e·s d’États, organisations internationales, parlementaires, fondations, et société civile —, la conférence de Paris s’est tenue dans un contexte tendu. La crise mondiale de l’aide publique au développement, les coupes budgétaires massives des bailleurs traditionnels et la fermeture de l’USAID ont fragilisé les financements destinés à la promotion de l’égalité. Parallèlement, les mouvements anti-droits progressent et s’organisent, des États-Unis à l’Europe en passant par l’Amérique latine. Face à cette offensive conservatrice, les diplomaties féministes apparaissent plus que jamais comme des outils essentiels pour défendre les droits des femmes, des filles et des personnes LGBTQIA+, et pour réaffirmer un engagement international fort en faveur de la justice de genre.
De même, les crises actuelles — guerres, dérèglement climatique, régressions démocratiques — rappellent l’urgence de replacer l’égalité de genre au cœur des politiques étrangères. Une paix durable ne peut se construire sans les voix minorisées. C’est tout le sens d’une diplomatie féministe : articuler les droits humains, la justice sociale, la redistribution économique et la démocratie dans chaque domaine de l’action internationale.
La conférence de Paris a ainsi permis d’interroger les pratiques diplomatiques encore trop marquées par les logiques patriarcales et militarisées, et d’ouvrir la voie à une réflexion sur des politiques extérieures plus inclusives, transformatrices et réellement féministes.
Les voix des activistes féministes francophones : regards croisés depuis la Conférence
Invitées par l’Alliance Féministe Francophone, Oumou Khairy Diallo, Bénédicta Aloakinnou, Yousra El Barrad et Nafissatou Hassane Alfari ont pris part aux débats de la conférence. Leurs interventions ont mis en lumière les réalités du terrain et les attentes fortes envers les diplomaties féministes.
Repenser le pouvoir : notre appel pour une diplomatie féministe inclusive et transformatrice
| Repenser le pouvoir, c’est accepter de redistribuer le pouvoir et les ressources. Repenser le pouvoir, c’est refuser de parler à la place des autres et construire ensemble une diplomatie féministe transformatrice. Repenser le pouvoir c’est repenser les femmes dans les contextes de crise et reconnaître leur participation aux processus de gouvernance et de paix. Repenser le pouvoir; c’est redéfinir le support comme une coalition solidaire qui donne confiance et liberté. Parce que tant qu’une femme, quelque part dans le monde, sera privée de liberté, aucune d’entre nous ne sera vraiment libre. Et sans les actrices de terrain, il n’existe pas de diplomatie féministe réelle. |
Oumou Khaïry Diallo (Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée)
Intervenant à la cérémonie d’ouverture de la Conférence sur les Diplomaties Féministes au nom de la société civile, Oumou dirige le Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée, mobilisant plus de 520 bénévoles pour l’éducation, la protection contre les violences et l’égalité des sexes.
“Je participe chaque jour à la vie des femmes et des filles sur le terrain. Je vois, j’écoute, je soigne et je reconstruis, souvent avec très peu, mais toujours avec conviction. Ces expériences me donnent une expertise unique, qui doit être reconnue comme telle. Pour moi, une véritable diplomatie féministe ne peut pas être une énième posture internationale, elle doit transformer profondément les rapports de pouvoir et les modes de décision. Je refuse une diplomatie construite sans nous, la société civile féministe. Elle doit nous inclure comme partenaires à part entière, et non comme simples consultantes. Chaque recul budgétaire, chaque désengagement international arrache de l’espoir à celles qui n’ont plus que nous. Instaurer une diplomatie féministe, c’est redonner justice à celles à qui la société l’a volée, et reconstruire nos sociétés sur la base de l’égalité et de la dignité, sans laisser personne pour compte.”
Yousra El Barrad (Fédération des Ligues des Droits des Femmes, Maroc)
Militante intersectionnelle marocaine engagée pour les droits des femmes et l’égalité de genre, Yousra agit à la fois sur le terrain et en plaidoyer juridique et politique, en favorisant le dialogue intergénérationnel et les approches transformatrices du genre.
“Je partage cette vision. Pour moi, la diplomatie féministe doit rester fidèle à sa vocation transformatrice. Elle ne peut pas se réduire à un slogan institutionnel ou à un cadre de coopération thématique. Elle doit remettre en question les hiérarchies, les inégalités et les logiques de pouvoir qui traversent nos sociétés et les relations internationales. Cela implique de financer et de soutenir les mouvements féministes de manière directe, durable et sans conditionnalité politique. Ces mouvements sont les moteurs de réponses transformatrices, enracinées dans la réalité des injustices vécues. La diplomatie féministe doit se construire avec les mouvements du Sud global, en partageant le pouvoir et en co-construisant les stratégies dans un esprit égalitaire et solidaire. Tant que la société civile restera cantonnée au rôle de “partenaire consultatif”, la diplomatie féministe restera incomplète. La force de cette diplomatie réside dans sa capacité à relier le local au global, à écouter et amplifier la pluralité des voix féministes, et à transformer ces engagements politiques en actions concrètes.”
Diplomaties féministes et contextes militarisés : repenser l’action internationale
Nafissatou Hassane Alfari (Women in Nexus, Niger)
Militante féministe nigérienne et cofondatrice de Women in Nexus, Nafissatou œuvre depuis sept ans à inclure femmes et jeunes dans les initiatives de paix et sécurité, en mobilisant médiation communautaire et plaidoyer.
“À partir de mon expérience sur le terrain, je constate que l’un des angles morts les plus persistants des diplomaties féministes est leur capacité à opérer dans des contextes où la démocratie est fragile, où la militarisation s’intensifie et où les transitions politiques redessinent les rapports de pouvoir. Ces réalités ne sont pas abstraites : elles concernent de nombreux pays confrontés à des régimes militaires ou à des périodes de transition instable. Dans ces environnements, les cadres institutionnels sont fragiles, les espaces civiques se resserrent, et les femmes engagées dans la défense des droits se retrouvent en première ligne, souvent sans protection suffisante.
Pour nous, militantes, il devient crucial de poser une question rarement discutée dans les grandes conférences internationales : comment une diplomatie féministe peut-elle rester pertinente et transformatrice dans un contexte dirigé par un régime militaire ou en transition ? Ce défi impose de repenser les partenariats, de créer des mécanismes d’appui flexibles et de reconnaître que la participation des femmes aux processus de gouvernance et de paix ne peut être suspendue en période de crise.
Une diplomatie féministe adaptée à ces contextes doit :
- maintenir des engagements clairs en faveur des droits humains, même lorsque le partenaire bilatéral s’inscrit dans un régime autoritaire ;
- soutenir les femmes médiatrices et leaders communautaires qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociale ;
- documenter et dénoncer l’impact des politiques sécuritaires sur les corps et les droits ;
- protéger les défenseures menacées ;
- garantir que les transitions politiques incluent systématiquement les femmes comme actrices centrales.
Ignorer ces réalités, c’est déconnecter la diplomatie féministe des terrains où les droits sont le plus menacés.”
Financer la société civile féministe : une coalition mondiale basée sur la solidarité et la confiance
Benedicta Aloakinnou (Fondation des Jeunes Amazones pour le Développement, Leadelles.com, Bénin)
Militante féministe et juriste béninoise, Benedicta dirige la Fondation des Jeunes Amazones pour le Développement (FJAD) et Leadelles.com, combinant activisme, technologie et plaidoyer pour la participation des femmes, la sécurité numérique et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
“Pour moi, la diplomatie féministe ne peut se réduire à des déclarations ou à des lignes budgétaires symboliques. Intervenir dans cet espace, c’est parler la langue des luttes, des vécus et des corps, celle qui a forgé mon militantisme à Lokossa, au Sud du Bénin. Aujourd’hui, nos mouvements font face à une triple menace : la précarité financière, le harcèlement et la criminalisation. Les coupes drastiques dans l’aide publique au développement, parfois jusqu’à 60 %, la réduction des financements internationaux pour les droits des femmes et la montée de mouvements anti-droits de mieux en mieux organisés rendent nos actions fragiles.
Un vrai financement féministe doit être direct, souple, durable et fondé sur la confiance. Moins de 1 % des financements mondiaux parviennent directement aux organisations féministes locales : cette réalité est insoutenable. Nos initiatives, comme Sang Pour Sang – Unies pour la Dignité ou Elles Pour Elles, montrent pourtant qu’avec un soutien réel, nous pouvons transformer des vies, mobiliser des femmes et créer des espaces de soin, de parole et d’action collective.
C’est pourquoi j’insiste sur l’urgence d’une solidarité internationale conçue comme une alliance politique, et non comme une aide verticale. La diplomatie féministe doit devenir une coalition mondiale où les capitales – Paris, Dakar, Niamey, Conakry ou Cotonou – échangent du pouvoir, des ressources et du respect, et non seulement des discours. Les organisations féministes ne veulent pas seulement être protégées : elles veulent être financées, crues et laissées respirer. Lorsqu’elles sont soutenues, elles deviennent une force de paix, de soin et de justice. La société civile féministe n’est pas fragile : elle est une force transformatrice. Et cette force, ce sont les femmes qui la portent. »
1Allemagne, Arménie, Australie, Belgique, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Espagne, Estonie, France, Irlande, Islande, Kosovo, Lettonie, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Mexique, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République dominicaine, Royaume-Uni, Rwanda, Slovénie, Thaïlande, Ukraine et Uruguay.
–
Equipop, aux avant-postes des diplomaties féministes
Depuis plus de trente ans, Equipop agit pour que la diplomatie française intègre pleinement les principes féministes. Présente à toutes les éditions précédentes de la conférence, l’association a joué un rôle clé dans la co-construction de la Stratégie internationale de la France pour une diplomatie féministe 2025-2030, en formulant des recommandations concrètes à travers ses travaux au Haut Conseil à l’Égalité et un document de positionnement sur le sujet.
Actrice du multilatéralisme féministe, Equipop contribue activement dans les espaces internationaux — de la Commission sur le statut des femmes aux coalitions comme Countdown 2030 Europe, Walking the Talk ou encore l’Alliance féministe francophone.
Face au recul mondial des droits, Equipop agit aussi comme observatoire du backlash, en documentant les offensives réactionnaires et en soutenant les résistances féministes à travers ses publications et actions de plaidoyer.