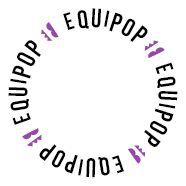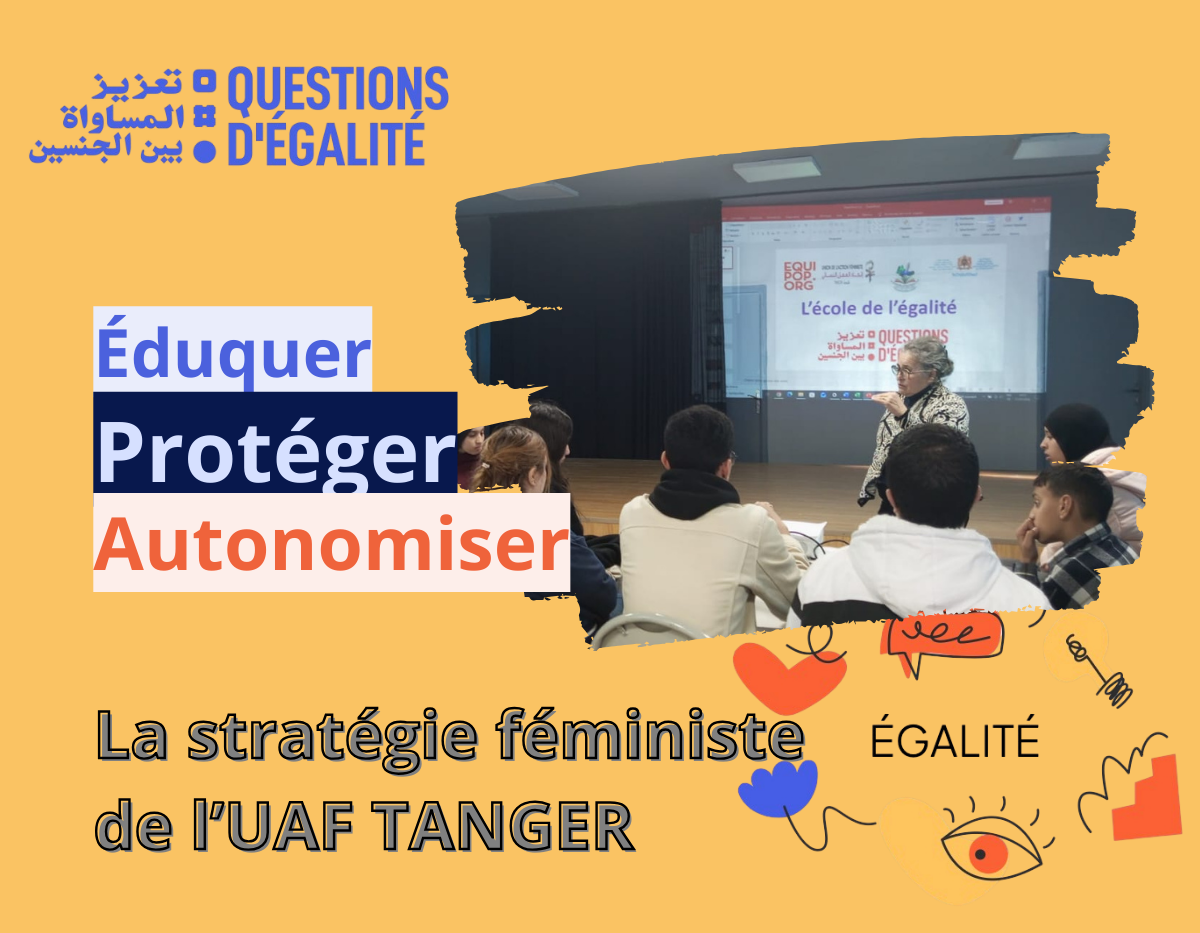Comment intégrer durablement l’égalité entre filles et garçons dans la prise en charge alternative ?
C’est le défi relevé depuis 2023 par SOS Villages d’Enfants France et Equipop, à travers le projet QUAPAO pour renforcer les dynamiques égalitaires au sein des villages d’Enfants SOS Togo, Niger et Côte d’Ivoire. Ce partenariat mise sur l’expertise d’un réseau de consultantes féministes ouest-africaines, qui mettent à la fois leur connaissance fine des contextes culturels et leur savoir-faire technique au service d’une transformation en profondeur des pratiques éducatives.
Le projet QUAPAO : Qualité de l’accueil en protection de l’enfance en Afrique de l’Ouest.
- Projet institutionnel (IPD) cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD), et SOS Villages d’Enfants France, en partenariat avec Equipop
- Période : 3 ans / phase 1 : 1er novembre 2023 au 31 octobre 2026
Objectif principal : Introduire la démarche qualité au sein de trois associations afin de garantir une prise en charge respectant les droits, besoins et attentes des enfants et jeunes accueilli.e.s par SOS Villages d’Enfants.
Mise en œuvre dans les associations Nationales (AN) Togo (3 villages), Niger (1 village) et Côte d’Ivoire (2 villages).
Ce que nous avons mis en place
L’approche genre est un prisme stratégique dans le projet QUAPAO, l’accompagnement s’est déployé sur trois niveaux complémentaires :
- Auprès des équipes SOS : diagnostics participatifs sur les enjeux de genre (éducation non sexiste, éducation complète à la sexualité, empouvoirement des filles, lutte contre les violences basées sur le genre) animation de débats, appui à la conception d’actions transformatrices ;
- Auprès professionnel·le·s : formations ciblées sur les pratiques éducatives égalitaires et accompagnement dans l’expérimentation d’initiatives concrètes favorisant l’égalité entre filles et garçons ;
- Auprès des enfants et jeunes : animation d’ateliers de formation et des groupes de paroles autour de l’éducation complète à la sexualité, développement de leur empouvoirement, la masculinité positive, féminité transformative, les violences basées sur le genre, éducation non sexiste et répartition des tâches ménagères, rêves et métiers sans limites de genre.
Pour faciliter l’acceptation de l’accompagnement, un soin particulier a été apporté à la présentation des consultantes. Bien que féministes et engagées dans la défense des droits des femmes, elles se sont d’abord positionnées comme spécialistes genre, mettant en avant leur savoir-faire technique tout en restant transparentes sur leur engagement.
Intégrer l’égalité des sexes dans la prise en charge alternatives : les axes développés dans QUAPAO
L’expérience du projet QUAPAO a permis de démontrer que l’égalité entre filles et garçons ne peut s’improviser : elle doit être pensée comme une dimension structurelle de la qualité éducative. L’accompagnement conduit par Equipop, a permis de développer un cadre d’actions articulé autour de quatre axes complémentaires qui orientent la transformation des pratiques dans les villages d’enfants SOS au Togo, au Niger et la Côte d’Ivoire.
- Identifier et documenter les inégalités
La première étape a consisté à rendre visibles les inégalités de fait qui marquent encore la vie quotidienne des enfants et des jeunes ainsi que des professionnel·le·s. À travers les diagnostics participatifs, les équipes et les familles ont pu analyser ensemble les pratiques éducatives, les dynamiques institutionnelles et les contextes communautaires. Ce travail a mis en évidence par exemple la persistance de divisons sexuées des tâches, ou encore des différences d’accès aux opportunités selon le sexe des enfants. Ces données ont ensuite nourri une réflexion stratégique collective, ouvrant la voie à des actions ciblées.
- Renforcer les cadres institutionnels en faveur de l’égalité
Parce que la durabilité des changements repose sur des référentiels solides, le projet a accompagné les AN dans l’élaboration de documents de pilotage intégrant explicitement la dimension genre. Qu’il s’agisse des plans d’amélioration de la qualité, plus tard les projets d’établissement ou des règlements internes, l’objectif a été d’inscrire l’égalité entre les sexes au cœur des normes de la prise en charge, tout en mettant en place des mécanismes de suivi garants de leur application effective. Cette formalisation contribue à inscrire la transformation dans le long temps.
- Transformer les pratiques éducatives et parentales
L’accompagnement a également ciblé les professionnel·le·s (Parents SOS, Assistante familiale, éducateur.trices de jeunes), afin que l’égalité devienne un repère concret dans la vie familiale. Les sensibilisations et formations ont porté sur l’importance de déconstruire de croyances discriminatoires, qu’il s’agisse des préférences de genre, de la répartition traditionnelle des tâches domestiques ou de certains stéréotypes éducatifs. Dans plusieurs villages, des initiatives éducatives ont été expérimentées pour favoriser une répartition plus équitable des responsabilités et encourager chaque enfant à développer des aspirations librement, indépendamment de son sexe.
Par ailleurs, la mobilisation des professionnel·le·s a été aussi cruciale : prendre en compte leur vécu professionnel et personnel en leur offrant des espaces dédiés a été un levier de changement important. Pour transformer les rapports éducatifs en faveur d’une plus grande égalité, il faut aussi que les parents puissent se déconstruire, comprendre leur propre histoire et trouver aussi un intérêt personnel et collectif (exemple sur la formation autour des Droits de femmes).
- Outiller les professionnel·le·s et autonomiser les enfants et jeunes
Enfin, le projet a insisté sur la nécessité de renforcer la capacité des professionnel·le·s à identifier et déconstruire les stéréotypes sexistes. Des temps de formation et d’accompagnement ont permis aux équipes d’intégrer cette vigilance dans leur quotidien, tout en initiant des actions de discriminations positive pour compenser certains déséquilibres constatés, notamment dans l’accès aux responsabilités ou aux activités scolaires et parascolaires. Dans le même temps, des espaces de dialogue ont été créés pour permettre aux enfants et aux jeunes de réfléchir eux-mêmes à l’égalité et de s’affirmer comme actrices et acteurs du changement au sein de leur village.
A travers ces quatre axes, QUAPAO a posé les bases d’une approche intégrée et systémique, qui permet non seulement de corriger les déséquilibres existants, mais aussi de transformer durablement la culture éducative et intentionnelle en faveur de l’égalité.

Les leviers phares identifiés
L’accompagnement mené dans le cadre du projet QUAPAO a permis de dégager cinq leviers déterminants pour ancrer durablement l’égalité de genre dans la prise en charge alternative. Ces leviers traduisent une approche à la fois pragmatique et profondément enracinée dans les réalités locales des Villages d’Enfants SOS Togo, Niger et Côte d’Ivoire.
- Adapter le langage et la posture pour lever les résistances initiales tout en restant fidèle aux valeurs défendues.
Lever les résistances initiales requiert un ajustement subtil du langage et de la posture. Les notions de genre ou de féminisme peuvent susciter des réticences si elles sont perçues comme abstraites ou éloignées des pratiques quotidiennes. Dans QUAPAO, les discussions ont été introduites à partir de concepts accessibles tels que « équité dans l’éducation » ou « respect mutuel », permettant d’instaurer un dialogue ouvert tout en restant fidèle aux valeurs portées.
Cette approche a facilité la mobilisation des équipes et des professionnel·le·s, en faisant émerger un engagement volontaire plutôt qu’une adhésion imposée.
- Co-construire les solutions avec les équipes et professionnel·le·s, en partant de leurs réalités et priorités.
La transformation des pratiques est durable lorsqu’elle est conçue collectivement. L’accompagnement à valoriser les connaissances et les priorités des acteur.e.s de terrains, en tenant compte de leurs contraintes et de leurs expériences. Dans plusieurs villages, cette co-construction a permis de mettre en place des initiatives concrètes, telles que l’instauration de temps de parole participatifs et d’écoute plus attentive favorisant un soin adéquat aux enfants et aux jeunes ou la réorganisation des tâches domestiques. Ces mesures, développées à partir de leurs réalités, ont renforcé le sentiment et favorisé l’appropriation des changements.
- Valoriser l’expertise locale en s’appuyant sur des consultantes ancrées dans les contextes culturels, mais ouvertes aux innovations pédagogiques.
L’expertise locale a constitué un levier fondamental pour la crédibilité et l’efficacité de l’accompagnement. Les consultantes ouest-africaines (Togo, Niger et Côte-d’Ivoire) mobilisées dans QUAPAO ont su conjuguer connaissance des contextes culturels et ouverture aux innovations pédagogiques. Leur ancrage local a permis d’anticiper les résistances et de proposer des solutions adaptées, tout en incarnant des rôles inspirants pour les équipes et les enfants et jeunes. Cette combinaison d’expertise technique et de légitimité sociale a renforcé l’adhésion et la confiance dans le processus.
- Créer des espaces de dialogue sécurisés pour questionner les représentations et déconstruire les préjugés.
La remise en question des normes de genre nécessite des cadres où chacun·e peut s’exprimer sans crainte de jugement. Les ateliers et discussions mis en place ont offert ces espaces bienveillants, favorisant l’expression des doutes et la confrontation des pratiques. Ces échanges ont permis de déconstruire progressivement les préjugés et de nourrir une réflexion collective sur l’égalité, tout en encourageant la co-constrution de solutions adaptées à chaque contexte familial et éducatif.
- Ancrer les acquis dans les pratiques et référentiels internes, afin que l’approche genre devienne une dimension naturelle de la qualité de la prise en charge.
Pour que l’approche genre devienne une dimension naturelle de la qualité éducative, il est indispensable de l’institutionnaliser. Dans QUAPAO, cela s’est traduit par l’intégration des principes d’égalité dans les référentiels d’évaluation interne, l’adaptation des procédures internes et la mise en place de suivis réguliers. Cette formalisation assure la pérennité des changements, permettant aux bonnes pratiques identifiées de se diffuser et de s’inscrire durablement dans le fonctionnement quotidien des villages d’Enfants SOS.

Les biais à éviter
L’expérience du projet QUAPAO a également permis d’identifier des écueils clés qui peuvent compromettre l’efficacité et la durabilité d’un accompagnement genre dans la prise en charge alternative.
- Imposer un discours ou/et une méthodologie déconnectés des réalités locales
Aborder la question de l’égalité de genre sans tenir compte des contextes culturels et institutionnels peut générer des résistances et limiter l’appropriation des actions. Dans certains villages SOS, l’emploi direct du terme « féminisme » au démarrage des ateliers a été perçus comme abstrait ou clivant par une partie des équipes. Pour surmonter cette barrière, le vocabulaire et le contenu des interventions ont été adaptés en les ancrant dans les pratiques quotidiennes et les préoccupations éducatives concrètes, permettant ainsi de mobiliser pleinement les équipes et de créer un dialogue constructif.
- Réduire le genre à un module de formation ponctuel, sans accompagnement dans la durée
La transformation des représentations et des pratiques nécessite un suivi continu. Lors d’une première série de formation, plusieurs parents SOS ont exprimé leur enthousiasme mais également leurs difficultés à appliquer les nouvelles approches dans leur quotidien. Sans un accompagnement prolongé, les acquis risquent de s’effacer rapidement. QUAPAO a donc mis en place des séances de suivi et des moments d’échanges réguliers, permettant aux participantes de partager leurs réussites, d’identifier les obstacles rencontrés et de consolider progressivement les changements, garantissant ainsi la pérennité de l’impact.
- Négliger la phase d’acceptabilité, condition essentielle à la. Mobilisation réelle des équipes.
Avant toutes interventions, il est crucial de créer un climat de confiance et de légitimité autour du projet. Certaines équipes craignaient qu’un accompagnement centré sur le genre ne remette en cause leurs pratiques établies. La présentation progressive dans consultantes, comme expertes techniques tout en étant transparentes sur les engagements féministes, a permis d’instaurer un cadre rassurant et de favoriser l’adhésion. Cette phase d’acceptabilité s’est révélée déterminante : elle a conditionné la participation active et l’appropriation réelle des principes d’égalité par toutes les parties prenantes.
Vers la capitalisation et la diffusion du modèle
La consolidation des quatre axes (identifier et documenter les inégalités, renforcer les cadres institutionnels en faveur de l’égalité, transformer les pratiques éducatives et parentales et outiller les professionnel.le.s et autonomiser les enfants et jeunes) développer dans QUAPAO ouvre naturellement la voie à une démarche de capitalisation et de partage des apprentissages. En structurant les pratiques éducatives autour de l’égalité des sexes et en intégrant ces principes dans les référentiels institutionnels, le projet fournit un socle pour produire des outils et méthodes transférables.
Equipop et SOS Village d’Enfants France envisagent ainsi d’organiser des moments de réflexion collective avec les consultantes et les équipes locales, afin de documenter les initiatives réussies et les transformations observées. Cette capitalisation permettra de créer des modules de formation et des repères opérationnels pouvant être adaptés à d’autres contextes au sein du réseau SOS en Afrique de l’Ouest. Au-delà de la documentation, il s’agit de favoriser la diffusion d’un modèle d’accompagnement genre intégré à la prise en charge alternative, qui inspire d’autres associations et institutions à inscrire durablement l’égalité entre filles et garçons dans toutes les dimensions de l’éducation et de la protection de l’enfance.
L’expérience QUAPAO illustre ainsi que la transformation des pratiques et des mentalités est possible lorsque rigueur technique, engagement institutionnel et dialogue culturellement sensible se conjuguent.