« Repenser des politiques de solidarité internationale feministes »
Dossier thématique
Repenser les politiques de solidarité internationale et de lutte contre les inégalités mondiales à partir des approches féministes
INTRODUCTION
On assiste depuis quelques années à la (ré)émergence, en France et ailleurs, de travaux de penseur·se·s, chercheur·se·s et philosophes qui déconstruisent, sous divers prismes, les grilles de lecture classiques qui ont structuré la pensée et les interventions sur le genre. Cet élan s’est traduit par un essaimage d’essais, d’articles dans des revues universitaires et scientifiques, de podcasts et émissions radio, de stands ou discussions féministes dans des événements culturels, qui irrigue, doucement, jusqu’au secteur de la solidarité internationale.
Trente ans après la Conférence de Pékin, on entend de plus en plus résonner dans les bureaux de nos organisations des mots comme « rapports de pouvoir », « intersectionnalité », « féminismes », « décolonialité », qui encore récemment étaient considérés comme tabous. Ces concepts, même s’ils ont, au fil des années, gagné en reconnaissance dans les milieux militants et de la recherche, ont tardé à être mobilisés dans le domaine de la solidarité internationale où on leur préférait ceux, moins engagés, d’« approche genre et développement » ou « gender mainstreaming ».
Nous devons l’arrivée de ces nouvelles perspectives en grande partie à l’émergence des études féministes postcoloniales, décoloniales et des « subaltern studies », qui redonnent de la visibilité à des savoirs souvent mis de côté ou invisibilisés et viennent bousculer la colonialité du savoir. Ces mots, toutefois, restent encore souvent enrobés d’un flou sur leur signification profonde, et se heurtent à un large fossé quand il s’agit de passer des idées à la pratique. La résonance de ces concepts dans le secteur de la solidarité internationale est relativement récente, après une longue période où ils ont nourri des réflexions fécondes dans les milieux militants et de la recherche dans divers territoires. Leur opérationnalisation dans les pratiques organisationnelles et dans les programmes et projets mis en œuvre dans le cadre de la solidarité internationale s’inscrit dans un processus graduel de maturation. Ce processus implique de la production de connaissances à large échelle ainsi que la mise en place de mécanismes et outils qui reflètent l’élan de déconstruction et la charge politique de transformation qu’incarnent les concepts évoqués. Dans ce sens, les approches féministes sont centrales dans la définition de politiques et pratiques de solidarité internationale respectueuses des droits humains et de l’égalité des sexes.
A travers ce premier dossier du Centre de Ressources d’Equipop, nous avons souhaité nous emparer de cette (re)visibilisation des pensées et des concepts féministes pour participer à l’émergence de nouvelles réflexions au sein du secteur de la solidarité internationale. Nous proposons des pistes de réponse à ces questions : au-delà de l’usage des mots, comment repenser les politiques et pratiques de solidarité internationale et de lutte contre les inégalités mondiales à partir des approches féministes ? Quelle place ont-elles dans nos pratiques de solidarité internationale ? Quelle critique de nos modalités d’intervention proposent-elles, et quelles leçons peut-on en tirer ? Comment peut-on s’inspirer des approches et concepts développés par les mouvements, activistes et penseur·se·s féministes pour faire évoluer la lutte contre les inégalités mondiales, à l’échelle de nos sociétés, de notre secteur et de nos organisations, et, renforcer les dynamiques de solidarité internationale ?
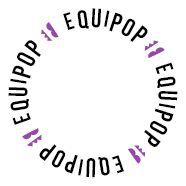
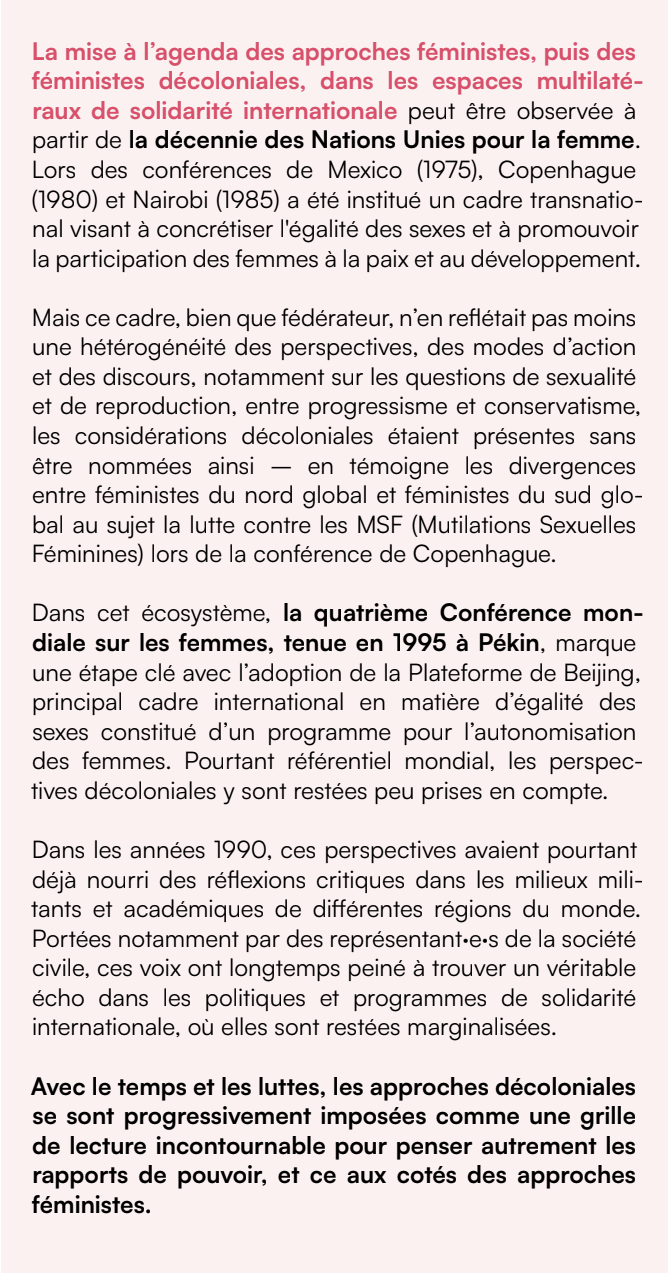

“L’usage de ces mots et ces conceptions donnent l’impression qu’on oublie qu’on essaie d’être vivants dans un système qui ne veut pas qu’on vive, qu’on défend nos territoires et nos vies face à des attaques continuelles. On sait quels sont nos besoins, ça n’est pas la question. C’est une question de structures et de rapports de force. Nos savoirs sont aussi tellement colonisés qu’il faut lutter pour démanteler ces structures.»
Miriam Nobre, lors de la Conférence Le féminisme décolonial en pratique: discutons-en! organisée par la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés (CCB) de l’Université Laval et le Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), 2022.
Cette réflexion s’inscrit dans une démarche plus large de questionnement du système de la solidarité internationale et de ses fondements historiques et culturels, qui nous semble primordiale dans le contexte actuel d’exacerbation des inégalités à l’échelle mondiale, et du backlash auquel font face les luttes pour les droits des femmes, des minorités de genre et sexuelles. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les institutions internationales qui sont au cœur de ce système, et les acteur·rice·s qui gravitent autour – parmi lesquels les ONG qu’elles financent – s’attachent à poursuivre un idéal de « développement » qu’il faudrait atteindre sur tous les territoires, à tout prix. Un idéal associé à une « modernité capitaliste » : développement économique, production, hausse du PIB, création d’emplois etc. Un modèle dont sont absentes les réflexions sur les rapports de pouvoir en jeu, les rapports postcoloniaux notamment, et des limites duquel témoignent la féminisation de la pauvreté, l’endettement des pays des Suds vis-à-vis des Etats qui les ont colonisés ou encore la destruction croissante du vivant.
“Les mouvements féministes et de femmes ont amplement participé à ces réflexions et ces cheminements politiques, associant décolonisation et «dépatriarcalisation» des pensées, des savoirs et des structures. Ils ont joué un rôle fondamental dans la formulation et l’expression contestataire à l’encontre des ordres idéologiques, politiques, économiques, environnementaux et sociaux, familiaux et de genre, sur lesquels s’est appuyé la mondialisation du capitalisme au cours du dernier demi- siècle et, sous son couvert, le développement.»5
VERSCHUUR Christine et DESTREMAU Blandine, «Féminismes décoloniaux, genre et développement. Histoires et récits des mouvements de femmes et des féminismes aux Suds», Revue Tiers Monde 2012/1 (N°209), 7-18, Ed. Armand Colin, 2012.
C’est dans le cadre de cette réflexion globale que nous convoquons les imaginaires, concepts, théories et approches féministes. Aujourd’hui, la galaxie d’idées et de courants féministes qui s’est construite à travers les temps et à travers le monde à partir des luttes des femmes et des personnes issues de groupes minoritaires est riche et complexe, et réunit des sensibilités diverses, qui varient selon les enjeux, les régions, les histoires sociales et coloniales. De ce fait, il nous semble fondamental de préciser les féminismes auxquels nous nous référons dans ce dossier : nous nous inspirons des féminismes intersectionnels, des féminismes des Suds – et notamment des féminismes Noirs, des afroféminismes, des féminismes de l’Abya Yala -, des écoféminismes, des féminismes décoloniaux, des féminismes dissidents et des théories queers et transféministes. Ce sont les concepts et approches qui ont émané de ces mouvements que nous mobilisons, en ce qu’ils ont pour dénominateur commun le refus des inégalités. En ce sens, nous souhaitons souligner l’importance d’être vigilant·e·s face aux discours néolibéraux se revendiquant féministes, qui insistent sur la responsabilité personnelle de chacun·e et suggèrent la possibilité d’une amélioration individuelle sans tenir compte des barrières structurelles qui sous-tendent ce modèle de la modernité capitaliste. Comme le dénonce Lea Sitkin, « le féminisme néolibéral promet la liberté, mais il ne fait que remplacer une source de coercition (l’autorité traditionnelle et patriarcale) par une autre (le marché). »
“Les crises multiples auxquelles sont confrontés la plupart des pays du Sud appellent un engagement stratégique plus large pour contrer les faux récits et promouvoir des solutions d’une manière structurellement féministe. Les systèmes d’oppression et de libération sont présents en chacun·e de nous, car nous ne sommes pas déconnectés du monde dans lequel nous vivons.»
OXFAM Novib, Feminist influencing basket of resources, 2024.
A travers ce dossier, nous souhaitons répondre à un enjeu de diffusion et de (re)visibilisation de savoirs et connaissances encore peu traduits en français, et proposer une mise en dialogue de ces perspectives avec celles des praticien·ne·s de la solidarité internationale pour envisager les possibles alternatives à la façon dont celle-ci prend forme. Nous nous adressons autant à celles et ceux qui ont déjà engagé une réflexion approfondie sur l’intégration du genre dans leurs pratiques de la solidarité internationale qu’à celles et ceux qui en sont aux premières étapes de ce cheminement.
“Depuis la chute du mur de Berlin et l’avènement du «monde unipolaire», les institutions de Bretton Woods – la Banque mondiale, le FMI, mais aussi l’ONU et ses multiples satellites – jouent un rôle croissant dans la mise en place d’un nouvel ordre économique mondial, derrière l’étendard officiel du «développement» et, plus récemment, de la «lutte contre la pauvreté». […] j’ai tenté de montrer, en suivant l’analyse d’une partie des féministes latino-américaines et caribéennes, que ces institutions présidaient à la réorganisation néolibérale du système mondial de production et de répartition des richesses, au détriment des femmes – principalement du Sud –, tout en se légitimant paradoxalement grâce à la participation d’un certain nombre de femmes et de féministes à ce projet.»
FALQUET Jules, «Genre et développement: une analyse critique des politiques des institutions internationales depuis la conférence de Pékin», On m’appelle à régner, édité par Reysoo F. et Verschuur C., Graduate Institute Publications, 2003.
I - Quand les intentions de changement se heurtent à des limites et détournements : apports des analyses féministes sur la prise en compte des inégalités dans les politiques et pratiques de solidarité internationale hier et aujourd’hui
Bien que l’intégration du genre dans les pratiques et politiques de solidarité internationale et de lutte contre les inégalités mondiales ait connu une adhésion croissante, permettant de visibiliser les rapports de pouvoir et la façon dont ils génèrent des inégalités et enclenchant des réflexions et initiatives pour lutter contre ces dernières, de nombreuses personnes chercheuses et militantes féministes identifient des limites majeures aux pratiques d’intégration du genre dans la solidarité internationale.
Dès 1970, Esther Boserup soulignait les effets néfastes des approches de développement sur les femmes sur le plan économique – et notamment les femmes des Suds, grandes perdantes de la poursuite du modèle de développement. A cette époque, les chercheuses et militantes constatent l’absence des femmes et de la prise en compte de leurs enjeux dans les pratiques et politiques de solidarité internationale. De cette critique découle l’adoption de nouvelles stratégies visant à « inclure » les femmes dans le développement. Plusieurs approches émergent, se succèdent ou se croisent : l’intégration des femmes au développement (IFD), les approches femmes et développement (FED), puis dans le tournant de la Conférence de Pékin en 1995, l’approche genre et développement (GED) qui – à la différence des précédentes – s’attache à prendre en compte les relations entre les genres et non seulement les femmes en tant que catégorie sociale.
Il faut noter que sur le plan socio-politique, diverses réflexions ont dans la même période, élargi le prisme des analyses sur les femmes des Suds. C’est dans cette lancée que l’angle thématique du droit a été pris en compte pour analyser par exemple « la situation juridique des femmes et l’impact de la coexistence de divers codes écrits ou non, avec lesquels les femmes peuvent jouer, que ce soit pour des questions foncières ou matrimoniales ». Dans la même mouvance, différentes prises de position émanant de femmes africaines sont nées en réaction au « constat que la production de connaissances et de cadres d’analyse est toujours dominée par des institutions et des personnes du nord et n’a pas suffisamment pris en compte les contributions, les pratiques et les vécus des Suds, conduisant à une colonialité des savoirs » (Oyèwùmi, 2002 ; Verschuur, 2009 et 2019 ; Abadie, 2017 ; Onibon, 2021).
Il faut dire que la diffusion des approches genre, et l’adhésion croissante, poussée par certaines organisations de la société civile, organisations internationales et bailleurs, a contribué à des changements importants en faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux autour des femmes, des filles et des minorités de genre et sexuelles dans leur diversité géographique et culturelle ainsi que d’un repositionnement de leur place dans l’échiquier des initiatives de solidarité internationale.
Toutefois, force est de constater que les pratiques d’intégration du genre dans ce secteur connaissent aujourd’hui de nombreuses limites et détournements. A ce sujet, la richesse des analyses féministes nous offre la possibilité d’un déplacement du regard essentiel pour reconsidérer nos pratiques.

“Il y a un énorme effort pour rendre le féminisme plus acceptable, le réduire à une phrase qui sonne bien ou à un refrain qui s’intègre dans une chanson. Le péril du féminisme, dans la dynamique de mainstreaming, a été sa dépolitisation, qui efface les idées politiques radicales qui sous-tendent le concept féministe.»
McFADDEN Patricia et TWASIIMA Patricia, “A feminist conversation: Situating our radical ideas and energies in the contemporary African context”, Friedrich Ebert Stiftung, 2018.
“Le mot genre a été détourné de son sens dans les programmes de coopération, où il est trop souvent encore considéré comme un buzzword. Plutôt que de s’en débarrasser par ennui, il est impératif, face à la persistance des inégalités, d’intégrer le genre dans le développement en tant que catégorie d’analyse, articulée avec les catégories de classe et de race, et de reconnaître les apports des études féministes postcoloniales aux études sur le développement.»
VERSCHUUR Christine, «Quel genre? Résistances et mésententes autour du mot «genre» dans le développement», Revue Tiers Monde 2009/4 (n° 200), 785-803, 2009.
L’une de ces limites tient à l’institutionnalisation et l’instrumentalisation même de l’approche genre. Ainsi, paradoxalement, alors que l’on voit les discours évoluer, que les enjeux de genre y sont de plus en plus mentionnés, que des concepts jusqu’alors ignorés du secteur de la solidarité internationale (comme l’intersectionnalité ou le concept même de féminisme) émergent, ces concepts se voient peu à peu vidés de leur substance critique et politique. Plusieurs chercheuses ont ainsi dénoncé la cooptation, ou la « colonisation discursive » de concepts militants et leur dépolitisation associée : « féminisme soft », « ONG-isation des féminismes », eurocentricité des approches proposées, « technocratisation du genre ». Il semble que le genre, trop souvent, soit utilisé au sein du secteur de la solidarité internationale comme un « buzzword » (de buzz en anglais : bourdonnement) ou un « fuzzword » (de fuzz : duvet, ou confus, d’après Cornwall, 2007). Ainsi, derrière le bourdonnement des mots et un vocabulaire qui bouge, peu de changement en pratique, et une remise en question insuffisante des barrières structurelles qui limitent notre capacité à lutter contre les inégalités mondiales.
Au-delà de cette critique de la cooptation des concepts, les penseuses, chercheuses et militantes féministes ont identifié d’autres enjeux fondamentaux qu’elles appellent à adresser pour réviser notre conception de la solidarité internationale. Des travaux ont ainsi mis en lumière la façon dont certains programmes – en s’attachant à poursuivre un objectif d’égalité de genre – maintiennent, voire alimentent, des hiérarchies sexistes et racistes. Par exemple des recherches sur l’assistance humanitaire aux personnes réfugiées au Bangladesh et en Thaïlande ont mis en évidence la façon dont les biais intériorisés par les travailleur·se·s humanitaires les ont amené·e·s à associer et réduire la question du genre tantôt à la simple mobilisation de la participation des femmes réfugiées (et ainsi à maintenir des préjugés sexistes où les femmes réfugiées sont considérées comme des partenaires plus honnêtes et fiables que les hommes, et à promouvoir une division sexuelle du travail de soin (care), tantôt à une nécessaire transformation des cultures « traditionnelles » des personnes réfugiées, perçues comme « arriérées », alimentant ainsi des dynamiques racistes par la négation de l’agentivité des personnes bénéficiant des programmes humanitaires et la concentration des pouvoirs de décision sur le personnel des ONG.
Vis-à-vis des personnes destinataires des interventions de solidarité internationale, les biais intériorisés par les praticien·ne·s de la solidarité internationale amènent encore l’invisibilisation, voire l’exclusion, des nombreuses personnes qui se trouvent à l’intersection de différents rapports de domination. Sans exhaustivité, les travailleuses et travailleurs du sexe (TdS), les personnes trans, les personnes détenues, les usager·e·s de drogues, les personnes vivant avec le VIH-sida, les personnes en situation de handicap etc. restent encore bien souvent en marge des interventions proposées, ou ne se voient « ciblées » par ces programmes qu’à travers des grilles de lecture biaisées et très souvent stigmatisantes (en témoignent les programmes de lutte contre le VIH-sida, qui ciblent les « populations clés » – parmi lesquelles TdS, personnes LGBTQIA+, personnes usagères de drogues, avec une approche de santé publique, au détriment d’approches plus englobantes qui permettraient d’axer des initiatives autour des besoins et intérêts exprimés par ces groupes de population.
Les critiques féministes s’attachent aussi à dénoncer le déséquilibre de pouvoirs entre les acteur·rice·s au sein du système. Certaines proposent ainsi de parler de « parties puissantes », plutôt que de parties prenantes, pour cesser d’esquiver la reconnaissance de la colonialité du pouvoir. Face à un système dans lequel les anciennes puissances coloniales concentrent les moyens et l’accès aux espaces de décision, il n’est pas possible d’ignorer les dynamiques postcoloniales et les rapports de pouvoir qui se jouent pour les acteur·rice·s et les habitant·e·s des territoires sur lesquels sont déployées les initiatives de solidarité internationale. L’imposition d’agendas déconnectés des priorités et intérêts des habitant·e·s de ces territoires, la mise à l’écart des organisations et mouvements féministes grassroots et les inégalités dans les partenariats – régulièrement qualifiés d’extractivistes pour souligner la façon dont ils extraient sans compensation, sans contribution ni reconnaissance, des connaissances et du travail – sont ainsi dénoncées de concert par celles qui analysent la solidarité internationale avec une perspective féministe.
“Les mouvements féministes des Suds contribuent à ébranler les ordres hégémoniques et à nourrir le renouvellement de la pensée et des actions sur le système.»
VERSCHUUR Christine et DESTREMAU Blandine, «Féminismes décoloniaux, genre et développement. Histoires et récits des mouvements de femmes et des féminismes aux Suds», Revue Tiers Monde 2012/1 (N°209), 7-18, 2012.
De ces limites émerge un constat sans appel : en maintenant le secteur de la solidarité internationale dans son état, il ne nous sera pas possible de nous attaquer de manière efficace aux inégalités. Aujourd’hui, en dépit des efforts et progrès réalisés pour intégrer une approche genre, notre secteur continue d’alimenter – même indirectement – la division internationale du travail, l’invisibilisation de l’économie du « care », et la marginalisation de certaines catégories de personnes. Dans cette perspective, les initiatives actuelles ne permettent pas de réelle redistribution du pouvoir, certains groupes ou individus se retrouvent encore en marge des politiques et initiatives de solidarité internationale. Les critiques féministes intersectionnelles nous proposent de repenser ces dernières pour les rendre réellement inclusives, rééquilibrer les rapports de pouvoir qui s’y jouent et lutter contre les violences structurelles, dans les Suds comme aux Nords. Pour dépasser ces impasses, nous proposons de nous inspirer d’un « féminisme pour les 99%» et de nous ouvrir à de nouvelles perspectives pour reconsidérer nos pratiques.
A travers ce dossier, nous souhaitons répondre à un enjeu de diffusion et de (re)visibilisation de savoirs et connaissances encore peu traduits en français, et proposer une mise en dialogue de ces perspectives avec celles des praticien·ne·s de la solidarité internationale pour envisager les possibles alternatives à la façon dont celle-ci prend forme. Nous nous adressons autant à celles et ceux qui ont déjà engagé une réflexion approfondie sur l’intégration du genre dans leurs pratiques de la solidarité internationale qu’à celles et ceux qui en sont aux premières étapes de ce cheminement.
“Les politiques doivent investir dans les femmes, leur accès à la terre, à des opportunités et à leur liberté. Les idées féministes peuvent améliorer la qualité de la vie et de la cohabitation, réduire les inégalités et atteindre la liberté de vivre dans la dignité et l’autodétermination (économique).»24
AKIYODE-AFOLABI Abiola, «Political participation, feminist organising and the creation of inclusive democratic spaces» publié dans la série «Réflexions féministes» du Groupe de Réflexion et d’Action Féministe Africain, Décembre 2020.
II - Ce que les approches féministes ont à nous dire : perspectives pour repenser nos sociétés, notre secteur et nos organisations
Les approches et pratiques féministes constituent des voies profondément prometteuses pour repenser collectivement nos sociétés et les équilibres mondiaux. Elles doivent particulièrement s’appliquer au domaine de la solidarité internationale. Il ne s’agit pas de se satisfaire d’aménagements à la marge, mais bien de concevoir de manière radicalement différente ce champ d’action, à travers nos relations avec les autres Etats, les organisations supranationales, les forums multilatéraux, et la société civile (formelle et informelle). Au-delà du secteur même de la solidarité internationale, ces transformations doivent aussi concerner, de manière impérative et urgente, nos manières de penser et de faire monde.
TRANSFORMATION N°1 - QUESTIONNER ET RENVERSER LES RAPPORTS DE POUVOIR POUR FAIRE SOCIETE AUTREMENT
Dette coloniale, imposition d’un modèle unique de « développement » et de « modernité », politiques d’ajustement structurel pilotées par les institutions internationales etc. Ces phénomènes sont autant de démonstrations du maintien aujourd’hui, de rapports de domination et de dépendances imposées entre les territoires anciennement colonisés – et les populations qui les habitent – et les (anciennes) puissances coloniales.

“Ce que j’appelle féminisme décolonial, c’est un féminisme qui, tout en reconnaissant qu’il y a une domination masculine, ne se focalise pas sur la question de l’égalité de genre.»
VERGÈS Françoise, Podcast Les Nuits de France Culture, 15 septembre 2019.
Les pensées féministes que nous convoquons dans ce dossier, par leur prisme décolonial et intersectionnel, nous invitent à repenser ces rapports de pouvoir et à réfléchir à d’autres manières de construire les relations internationales et la gouvernance mondiale. Il s’agit d’examiner le système – profondément inégalitaire – sur lequel a été bâti le secteur de la solidarité internationale : repenser la lutte contre les inégalités mondiales ne peut faire l’économie d’une réflexion globale sur les bases mêmes des relations internationales et du système économique global. Il ne s’agit pas uniquement de questionner ces racines inégalitaires, mais d’envisager, afin de poser des bases pour faire société de façon juste et équitable, de réparer les injustices et oppressions passées ou actuelles. Dans cette perspective, nous invitons à regarder les pistes proposées pour la réparation des crimes humains, économiques et écologiques qui ont permis l’instauration du système-monde d’aujourd’hui : annulation des dettes coloniales, réparations (politiques, mémorielles mais aussi financières) en faveur des descendant·e·s d’esclaves, actions en justice pour la reconnaissance et la réparation des crimes environnementaux (à l’instar des actions initiées suite au scandale du chlordécone aux Antilles, soutenues par des collectifs féministes comme le Koumbit Fanm Karayib), etc.
Il faut noter que ces positionnements ne font pas toujours l’unanimité, notamment au niveau des acteurs des Suds. A titre d’exemple, la revendication de réparation n’est pas forcément vue comme une démarche résiliente par tous. Il existe une tendance à se distancier du ressentiment et de la référence au passé qui, bien souvent, prêtent le flanc à des accusations de victimisation. D’où la question de savoir si le focus aujourd’hui n’est pas beaucoup plus de procéder à une relecture des pratiques même de solidarité internationale, pétries de relations de pouvoir à tous les niveaux.
Au sein du secteur de la solidarité internationale plus spécifiquement, cette reconnaissance des rapports de pouvoir en jeu (et de la présence de « parties puissantes ») appelle une évolution des interactions entre acteur·rice·s et encourage la reconnaissance des privilèges et des endroits d’énonciation et d’action de chacun·e. La chercheuse franco-camerounaise Rose Ndengue nous invite à nous poser cette question : « Comment faire de ma positionnalité un levier d’émancipation pour les communautés auxquelles je me rattache ? » Se poser cette question, en tant qu’acteur « puissant » au sein du système de solidarité internationale, en tant qu’organisation internationale ou bailleur par exemple, implique de reconnaître ses pouvoirs et privilèges, et d’explorer la façon dont ces derniers peuvent être activés au service des parties prenantes qui n’ont pas accès aux mêmes opportunités, aux mêmes espaces de prise de parole et de prise de décision. Il s’agit ainsi d’explorer la façon dont nous, « parties puissantes », pouvons adopter une posture d’allié·e·s auprès des associations de terrain, mouvements sociaux et activistes et représenter, relayer et visibiliser leurs intérêts et demandes. Il s’agit de convoquer le principe du « rien sur nous sans nous » (« Nothing about us without us »).
Cette posture d’allié·e·s nous invite aussi à questionner et faire évoluer nos positions, en tant qu’organisations de solidarité internationale, au sein des mécanismes et canaux de financements.
Des travaux ont été réalisés à ce sujet et méritent de gagner en visibilité, mais surtout en appropriation pour enclencher une réelle redistribution des ressources dans le secteur : comment repenser les financements pour les rendre plus accessibles aux mouvements (y compris les mouvements non déclarés et/ou informels), organisations grassroots et activistes sur le terrain ? Parmi leurs demandes déjà identifiées, on retrouve : renforcer la disponibilité de financements pluriannuels, alléger les conditions d’accès aux financements, baser les critères de financement sur le travail réalisé sur le terrain, fluidifier les processus, développer en parallèle du financement des opportunités de mise en réseau, de renforcement des connaissances, repenser la participation des organisations grassroots dans les espaces d’élaboration et d’octroi desdits financements etc.
“Il y a actuellement un retour en arrière contre une grande partie des progrès réalisés dans les années 1990 en matière de droits des femmes, dans un contexte de crises économiques, sociales et politiques complexes. Les organisations internationales de développement qui prennent au sérieux les droits des femmes et l’égalité de genre doivent faire plus que ce qu’elles font actuellement pour soutenir les organisations et mouvements de femmes internationaux, nationaux et locaux qui élaborent des réponses politiques aux crises qui se déroulent dans le monde entier. Cela implique que les féministes d’identités et de lieux différents travaillent en solidarité pour protéger les avancées en matière de droits des femmes et pour les faire progresser.»
SWEETMAN Caroline, “Introduction, Feminist Solidarity and Collective Action”,
revue Gender & Development, Vol. 21, No.2, 2013.
Ainsi, à l’échelle du secteur de la solidarité internationale, repenser les rapports de pouvoir nous invite à inverser le postulat de départ : il ne s’agirait plus d’élaborer des stratégies et programmes de financement vers un objectif donné (aussi juste soit-il), en allant à la recherche de partenaires adéquats et en leur dictant les conditions dans lesquelles ils pourront s’insérer dans les initiatives ainsi élaborées, mais de se positionner comme allié·e·s des solidarités féministes transnationales.
Enfin, à l’échelle de nos organisations aussi, les rapports de pouvoir doivent être reconnus et adressés. Comment amener un changement dans nos interventions si en interne, certaines personnes subissent des rapports d’oppression ou des discriminations, ou encore si certaines personnes sont absentes ? C’est en repensant nos pratiques de recrutement et de gestion des ressources humaines, d’abord, que nous pourrons enclencher un changement : mettre en place des pratiques de recrutement équitables, encourager la représentativité au sein de nos équipes des personnes minorisées (sur le plan du genre mais pas uniquement, dans toute leur diversité) et assurer que les conditions de travail qui leur sont proposées soient justes, équitables et adaptées. A cela s’ajoute la nécessité de favoriser l’interculturalité dans les pratiques RH en prenant garde à ne pas reproduire inconsciemment, des rapports de pouvoir et des asymétries entre personnes de cultures différentes. Ainsi, mettre le bien-être des personnes au centre des pratiques de gestion des ressources humaines s’avère primordial. De nouveau, au sein de nos organisations, nous invitons à convoquer le principe d’autoréflexivité et à encourager l’exploration des biais intériorisés auxquels personne ne peut échapper. La reconnaissance de l’existence de rapports de pouvoir dans nos organisations suggère aussi la mise en place systématique de mécanismes transparents de gestion des dynamiques internes de pouvoir et des tensions ou conflits. De nouveau, les réflexions féministes ont beaucoup à nous apprendre sur ces questions.
Dans son essai Comment s’organiser ? Manuel pour l’action collective, l’autrice écoféministe Starhawk tire ainsi de ses expériences au sein de mobilisations écologistes et altermondialistes et de ses expériences spirituelles des pistes pour organiser l’action collective. Elle y souligne notamment l’importance, pour tout collectif, de trouver un équilibre entre le pouvoir et les responsabilités, insistant sur la nécessité que le pouvoir puisse être lié à la prise de responsabilités et soulignant le caractère essentiel de la présence de mécanismes de transparence, de redevabilité et de la possibilité d’une critique constructive. Elle propose également des outils concrets pour réfléchir davantage autour de cette question du pouvoir dans les groupes, en l’associant aux notions de confiance et de communication, de lutte contre les inégalités liées aux privilèges, de limites et de partage du pouvoir, de soin pour les personnes qui prennent des responsabilités, etc.
Ces propositions, transposées à nos organisations, permettent d’initier des réflexions sur la répartition du pouvoir et des responsabilités, et sur la reconnaissance des privilèges existants au sein de nos équipes, qui peuvent être liés aux enjeux de genre, d’âge, de classe ou de race, mais aussi au capital social, culturel et éducatif des personnes. Conditionner l’accès à certains postes à la possession d’un diplôme universitaire sans ouvrir la possibilité à des personnes disposant d’une expérience personnelle ou professionnelle majeure mais non diplômées d’obtenir de tels postes, peut revenir à renforcer des déséquilibres de pouvoir et des privilèges existants. Se poser la question des barrières (financières, sociales, géographiques, linguistiques, de genre etc.) à l’accès à une formation académique et aux diplômes peut être une première piste pour éviter ce type de biais. De la même manière, nos organisations sont encore très souvent structurées sur le modèle d’un siège éloigné du « terrain » et situé aux « Nords », et d’antennes ou de bureaux localisés sur le terrain, dans les « Suds ». Pour reconnaître et faire face de façon transparente aux dynamiques de pouvoir existantes, nous ne pouvons faire l’impasse sur un questionnement autour du poids de ces bureaux et composantes d’une organisation dans les prises de décision de cette dernière. Les nombreux travaux sur la localisation de l’aide, qui ont gagné en visibilité au cours des dernières années, offrent des pistes de réflexion cruciales pour rééquilibrer la balance.
TRANSFORMATION N°2 : REHABILITER LES SAVOIRS INVISIBLES ET LES SAVOIRS PERDUS, REPLACER L’EXPERIENCE ET LE VECU AU CENTRE
Les critiques de la colonialité du savoir et de nombreux travaux féministes et décoloniaux ont mis en exergue la façon dont l’instauration du système néolibéral actuel s’est accompagnée de l’invisibilisation, la décrédibilisation, voire la criminalisation de certaines pratiques de transmission de savoirs et de connaissances. Un exemple phare est celui de la répression historique des femmes soignantes par l’Eglise, soutenue par les Etats européens, du 14ème au 17ème siècle, et dans sa continuité, la mise à l’écart des médecines traditionnelles et des connaissances médicinales développées par les femmes par l’institution médicale en Europe et ailleurs. Face à cette critique, nous identifions l’enjeu de repenser la notion de « savoir », et de reconnaitre notamment la valeur des savoirs expérientiels et non professionnalisés.
“Les écoféminismes dénoncent la primauté du rapport scientifique sur le monde, issu d’un projet colonial et patriarcal qui s’historicise de plus en plus.»
“Des personnes vieilles, aux genres illisibles, redonnaient du pouvoir à des minorités avec l’aide de plantes, d’animaux, d’esprits, invoquaient et créaient une classe de dissident· es en choisissant elleux-mêmes les termes de leur existence.»
BAHAFFOU Myriam, Des paillettes sur le compost. Ecoféminismes au quotidien,
Ed. Le passager clandestin, 2022.
Cet enjeu se traduit là encore à différents niveaux. A l’échelle mondiale, le soutien à l’émergence et à la diffusion des subaltern studies – déjà enclenché – et des connaissances qu’elles produisent, semble fondamental. Au-delà de rendre ces savoirs visibles, il s’agit aussi de leur offrir une place réelle – et non symbolique – dans les sphères de décision. Une illustration de cet enjeu peut être trouvée dans la défense des droits des peuples autochtones, qui détiennent des savoirs et pratiques uniques et cruciales pour la sauvegarde des écosystèmes et la protection de la biodiversité. Du fait de leur rapport au monde et au vivant, ces peuples ont développé des pratiques qui semblent fondamentales à l’heure des réflexions pour faire face au changement climatique. Et pourtant, les processus décisionnels continuent de les exclure, et leurs droits aux terres et aux ressources d’être violés. Intégrer ces peuples dans les politiques climatiques à l’échelle mondiale, reconnaitre leurs droits et les respecter, semble vital, non seulement dans une démarche de respect des droits humains, mais aussi de sauvegarde d’un écosystème mondial au cœur duquel l’ensemble de l’espèce humaine évolue.
A l’échelle du secteur de la solidarité internationale, ces réflexions autour de la notion de « savoir » nous invitent à reconnaître la diversité de perspectives qui peuvent exister sur les différents sujets dont s’empare le secteur, et sur la nécessité de les prendre en compte dans l’élaboration des politiques et dans nos pratiques. Des initiatives menées dans le champ de la réduction des risques auprès des personnes usagères de drogues, de travailleur·se·s du sexe, ou encore des personnes LGBTQIA+, ont démontré l’intérêt primordial de soutenir les associations et mouvements communautaires, et d’offrir aux personnes qui détiennent des savoirs expérientiels une place centrale dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes. Dans ce sens, les programmes sur ces domaines recourent depuis toujours au « travail des pair·e·s » et s’attachent à permettre aux personnes concernées d’œuvrer et de piloter les initiatives qui les ciblent, sur la base du principe « Nothing about us without us ». Ces savoirs expérientiels, non professionnalisés, non académiques, ont démontré leur caractère incontournable. Dans le champ de la santé, des initiatives de promotion de la démocratie en santé s’inscrivent dans la même perspective, faisant de la reconnaissance de la diversité des registres de savoirs un enjeu crucial, et invitant à redéfinir la valeur et le sens de « l’expertise », en donnant toute sa place à l’expérience de chacun·e à travers un processus de démocratisation du savoir. Ainsi, de manière générale, les organisations, bailleurs et décideur·se·s au cœur du système de la solidarité internationale devraient repenser la place des personnes concernées au sein des espaces d’élaboration des politiques et programmes, en questionnant les rapports de pouvoir existants entre praticien·ne·s du secteur et « communautés » concernées par les initiatives mises en place.
Reconnaître et valoriser à leur juste valeur les savoirs non professionnalisés, et les savoirs minorisés, implique aussi de faciliter et favoriser le travail collaboratif, la co-création et la construction de savoirs collectifs, en impliquant toujours les personnes concernées. Cela nécessite de repenser la façon dont sont construites les alliances et de proposer des partenariats égalitaires, articulés autour de cadres de réciprocité et permettant le renforcement mutuel. Il s’agit aussi de soutenir les processus créatifs et les formes alternatives d’action, de plaidoyer, d’influence.
Les luttes écoféministes ont, à cet endroit, beaucoup à nous apprendre, en ce qu’elles ont démontré, à différents endroits et à différents moments, la puissance transformatrice des pratiques créatives, de l’artivisme et des formes de mobilisation alternatives.
“Prôner la simple tolérance de la différence entre les femmes est une grossière erreur. C’est un déni total de la fonction créative de la différence dans nos vies. En effet, la différence ne doit pas être simplement tolérée, mais considérée comme un fonds de polarités nécessaires entre lesquelles notre créativité peut jaillir.»
LORDE Audre, Sister outsider; essais et propos sur la poésie, l’érotisme, le
racisme, le sexisme, 1984 (Traduit par M. Calise, Mamamelis, 2018).
Les mouvements féministes nous invitent aussi à valoriser le potentiel de la différence et de la diversité. Ce potentiel peut être réactivé en repensant les espaces de partage de savoirs, de formation ou de prise de décision du secteur de la solidarité internationale. Nous proposons ainsi de repenser nos espaces de rencontre et de réflexion en créant des espaces démocratiques réellement inclusifs, y compris des espaces virtuels, ce qui implique de questionner leur accessibilité.
Dans le cadre de l’organisation d’événements en présentiel, des considérations sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, des minorités de genre et sexuelles, des personnes de différents statuts socioéconomiques, des personnes exerçant différentes activités productives et reproductives ou aux pratiques culturelles variées doivent être prises en compte dès la conception de l’évènement afin d’en assurer l’inclusivité effective. Selon les sujets discutés au sein des espaces de réflexion mis en place, la question de l’ouverture de l’espace est un enjeu majeur : penser, avec les personnes concernées, la non-mixité ou les modalités de mixité choisie, est une démarche qui peut avoir un réel effet levier sur l’ouverture de possibilités de prise de parole et d’écoute, d’espaces de prise de conscience féministe et de partages d’expériences, ou encore sur la visibilité de certaines inégalités sociales et leur possible dénonciation. Enfin, la mise en place ou le soutien à des communautés d’intérêt, incarnées par les écoles féministes et les groupes d’échanges féministes solidaires, des clubs féministes dans les écoles, des groupes de discussion sur les questions de genre dans les villages, des groupes de travail ou commissions sur les questions féministes dans les partis politiques, les syndicats ou les institutions publiques etc. sont aussi une piste à explorer pour renforcer la participation et l’accessibilité de toutes et tous aux savoirs et à l’élaboration collective de propositions et d’initiatives favorables au changement : de tels environnements représentent un forte potentiel d’incubation d’idées et de consciences féministes, et gagneraient à être développés pour exister à de multiples niveaux.
Au sein de nos organisations, il semble fondamental aujourd’hui de repenser la façon dont les savoirs et expertises sur le genre sont concentrées, réparties et mobilisées au sein des équipes : Qui possède ces savoirs ? Quels savoirs sont reconnus ? Tiennent-ils compte d’une approche intersectionnelle ? Quelles connaissances sont diffusées en interne sur les enjeux de genre, et comment ? Les personnes concernées ont-elles de l’espace pour exprimer librement leurs points de vue sur ces enjeux, leurs priorités, leurs conceptions ? Les concepts de genre tels qu’ils sont abordés au sein de nos organisations ont-ils conservé leur substance politique d’origine – celle qui leur a été octroyée par les théoricien·ne·s, penseur·se·s et militant·e·s féministes de divers horizons qui les ont élaborés – ou ont-ils fait l’objet d’une cooptation au point d’être vidés de cette substance et d’être transformés en concepts et outils technocratiques ?
Face aux réponses que nous trouverons à ces questions, plusieurs pistes peuvent être proposées, comme la mise en place d’initiatives pour faire émerger et cultiver une culture commune féministe au sein des organisations, la réflexion sur la concentration ou la répartition des expertises sur le genre dans les équipes, sur leur transmission et la formation en interne, la diffusion et l’accès aux travaux des féministes militant·e·s des Suds, de féministes radicales·aux, et des féministes intersectionnel·le·s, etc.
TRANSFORMATION N°3 : Placer le soin et l’entraide au coeur de nos pratiques societales et collectives
“Pour moi, les écoféminismes représentent un ensemble de
mouvements qui prônent la vie sous toutes ses formes, une
sorte de valorisation de l’énergie vitale contre toute l’entreprise
mortifère civilisationnelle coloniale. (…) C’est probablement
pour cela que le care, les relations auprès des personnes
malades, vieilles, mortes, ou qui enfantent, sont au cœur des
luttes écoféministes. D’ailleurs, c’est bien de cela qu’il s’agit
quand on parle d’écologie: des corps et de leurs différentes
interactions écosystémiques, de leurs moyens de coopération et de compétition, des communautés qui bougent, communiquent et s’organisent au sein de milieu précis. En somme, les écoféminismes construisent une politique qui œuvre à partir du corps comme élément interconnecté au vivant, ouvert et en relation constante aux autres espèces.»
Myriam Bahaffou, 2023.
Au-delà de les convoquer à l’échelle du secteur, nous souhaitons rappeler dans un premier temps qu’elles sont primordiales à l’acte même de faire société. Pourtant, au sein de nos sociétés humaines, de multiples hiérarchies agencent nos rapports sociaux. Parmi elles, la division sexuelle du travail engendre notamment une survalorisation des activités productives au détriment des activités reproductives (soin aux autres, entretien des espaces domestiques, travail de care, etc.). Ces dernières sont pourtant fondamentales – là encore, à la survie même de notre espèce. Nombre de penseuses féministes ont mis en avant le caractère essentiel du soin : soin aux plus jeunes, aux personnes malades, aux personnes âgées, soin aux travailleur·se·s engagé·e·s dans des activités productives et à l’ensemble de nos communautés. L’épidémie et la « crise » du COVID en ont été le reflet. Ce constat des interconnexions et des interdépendances entre activités de care et autres activités, et finalement des interdépendances entre humain·e·s, nous appelle à repenser l’ordre économique mondial, et – comme l’ont souligné les féministes marxistes et tiers-mondistes depuis les années 70 – à mettre en place une économie du care.
Au-delà même d’un travail visant à éradiquer les hiérarchies au sein des activités humaines, et de celles et ceux qui les mènent, il est fondamental de reconsidérer les systèmes de valeur dominants qui tendent à détacher l’espèce humaine de son environnement de vie. Nos corps humains interagissent continuellement avec le reste du vivant. La crise climatique est indissociable de la survie de notre espèce et des autres espèces avec lesquelles nous cohabitons. Il s’agit d’identifier des solutions pour lutter contre le changement climatique, restaurer la biodiversité et réparer les dégâts de l’activité humaine sur nos environnements. Les perspectives écoféministes nous invitent notamment à réhabiliter des manières de relationner, entre humain·e·s et au sein des écosystèmes dont nous faisons partie, basées sur le respect mutuel et refusant la possibilité de rapports de destruction, d’extraction et d’extinction.
Cette proposition nous semble d’autant plus impérieuse que le contexte dans lequel nous rédigeons ce dossier est celui d’une situation écocidaire à différents endroits de la planète, face auxquelles le silence de nos gouvernements (et leur complicité) est alarmant.
Au sein du secteur de la solidarité iternationale, nos organisations, institutions, structures, ont un rôle fondamental à jouer dans l’instauration de relations axées sur le soin et la protection du vivant. Nous nous devons de reconnaître le continuum indéniable qui lie les inégalités mondiales que nous souhaitons éradiquer et les violences structurelles qui se jouent et sont perpétuées par le système-monde. Reconnaître les liens entre capitalisme, impérialisme, extractivisme, hétéropatriarcat et racisme, dans le but de démanteler un système et d’en reconstruire un nouveau, protecteur et exempt de violence. En tant qu’acteur·rice·s de la solidarité internationale, et en tenant compte de nos positionnalités de « parties puissantes », nous avons un rôle dans la visibilisation de certains enjeux et mouvements sociaux au sujet desquels nous sommes souvent silencieux·ses. Comment plaider pour la régulation des conflits et la paix mondiale si nous ne soutenons pas celleux qui dénoncent la violence extrême de certains Etats : violence génocidaire d’Israël en Palestine, violences policières, violences et exactions des forces armées étatiques, violences au sein du système carcéral, etc. ? Comment prôner l’égalité et la liberté de toutes et tous si nous ne prenons pas position en faveur des droits et revendications des peuples autochtones, des luttes contre l’extractivisme et des autres luttes environnementales qui se battent contre l’annihilation du vivant ? Comment dénoncer les inégalités sociales si nous ne soutenons pas les mouvements pour les droits des travailleur·se·s (y compris les travailleur·se·s les plus marginalisé·e·s, parmi lesquel·le·s les travailleur.se·s du sexe), les mouvements de lutte contre la précarité et les mouvements antiracistes partout dans le monde, y compris sur les territoires des « Nords » souvent ignorés par nos propres politiques et pratiques de lutte contre les inégalités ? Comment défendre l’égalité de genre si nous invisibilisons les luttes pour les droits des personnes LGBTQIA+ au prétexte qu’elles clivent ou que les mouvements « anti-genre » détournerons nos propos ? Comment, enfin, soutenir le droit de toutes et tous à la santé, à la nutrition, à la vie, sans questionner les systèmes de production, d’exportation et de consommation qui nous nourrissent, l’impact dévastateur de certaines politiques agricoles sur celle et ceux qui travaillent la terre, sur les environnements ruraux et celle et ceux qui les habitent, et des pratiques d’échange qui perpétuent une exploitation postcoloniale de certains territoires ?
En tant qu’acteur·rice·s de solidarité internationale, nous appelons à l’instauration de liens de solidarité réels avec ces différents mouvements sociaux, dans une perspective transnationale. Nous nous proposons d’incarner le concept de « solidarité transnationale féministe », sans le dépolitiser, sans le vider de sa substance, et de prendre position et de faire corps, ensemble, pour défendre la liberté face aux enjeux capitalistes, impérialistes et racistes qui structurent le monde. Ces solidarités peuvent de nouveau recourir à la posture d’allié·e·s : les organisations les plus puissantes, installées au sein du système de la solidarité internationale et dont la place et la légitimité sont reconnues par les autres acteur·rice·s – notamment les Etats –, peuvent soutenir les associations ou les mouvements les plus précaires, en prenant notamment la charge mentale, et financière, de l’analyse des risques de sécurité auxquels leurs membres peuvent être exposé·e·s et en mettant en place des mécanismes de soutien et de protection.
“Les généalogies féministes ont attiré l’attention sur trois éléments importants dans notre définition du transnational: 1) une façon de penser les femmes dans des contextes similaires à travers le monde, dans des espaces géographiques différents, plutôt qu’à toutes les femmes du monde entier; 2) une compréhension d’un ensemble de relations inégales entre les peuples et au sein de ceux-ci, plutôt qu’un ensemble de traits incarnés par tou·te·s les citoyen·ne·s non-américain·e·s (en particulier parce que la citoyenneté américaine continue d’être fondée sur un régime blanc, eurocentrique et hétérosexiste); et 3) une réflexion sur le terme «international» en relation avec une analyse des processus économiques, politiques et idéologiques qui nécessiteraient donc de prendre des positions critiques antiracistes et anticapitalistes qui rendraient possible le travail de solidarité féministe.»
ALEXANDER M. Jacqui et MOHANTY Chandra Talpade, Feminist genealogies,
colonial legacies, democratic futures, 1997.
Enfin, au sein même de nos organisations, les questions de bien-être, de soin et de sécurité doivent aussi retrouver une place centrale. Promouvoir le soin des équipes (y compris celles et ceux qui occupent des postes de « première ligne », ou des positions plus précaires dans le cadre de stages ou de bénévolat), mettre en place des dispositifs pour soutenir l’accès de tou·te·s à des dispositifs de soutien psychosocial et des soins en santé mentale, reconnaître les apports des approches « trauma-informed », sont autant de pistes que nous offrent les réflexions féministes. Les difficultés rencontrées par les personnes engagées dans la lutte contre les inégalités mondiales, qu’elles le soient au travers d’une activité professionnelle au sein d’une ONG, en tant qu’activistes de terrain ou chercheur·se·s, sont nombreuses et ne sont plus à démontrer. L’épuisement militant ou professionnel est souvent perçu, voire normalisé, comme un revers inévitable de l’engagement pour la justice sociale. Des organisations féministes à l’instar de l’Association for Women in Development (AWID), du Fonds d’Action d’Urgence pour le militantisme féministe ou du Fonds Féministe FRIDA se sont saisies de ce problème il y a déjà quelques années, proposant une remise en question de ce paradigme. « La pérennité implique d’être capable de faire le travail que l’on aime tout en étant épanouie et heureuse dans tous les domaines de notre vie. Cela implique de se sentir en sécurité, connectée, reconnue, respectée et appréciée pour ce que l’on est autant que pour ce que l’on fait». Ce constat de la militante Jane Barry doit nous inviter à questionner les pratiques de nos organisations, et ce qu’elles induisent chez les équipes en termes de difficultés à combiner engagement militant et associatif et épanouissement personnel : Comment nos organisations soutiennent-elles leurs membres dans la recherche de cet équilibre ? Comment protègent-elles le personnel qui peut être exposé à des risques pour sa sécurité et sa santé du fait de son engagement dans l’organisation ou pour d’autres raisons ? Comment nos organisations rendent-elles possibles la réalisation de l’idée que « s’occuper de soi est un acte politique » et acceptent-elles de jouer un rôle effectif dans ce projet ? Nos pratiques des ressources humaines permettent-elles à chacun·e d’avoir accès à la santé, d’avoir du temps pour des projets et activités en dehors du travail, pour sa famille, pour du repos, pour des loisirs, pour ses réseaux de sociabilité ? Quelles sont les définitions de la « sécurité » auxquelles ont recours nos organisations, et englobent-elles des sujets comme la santé physique et mentale et le bien-être, la protection contre l’exclusion, l’accès à la justice, ou encore la protection face à certaines formes de violences spécifiques à certains groupes sociaux, parmi lesquelles les minorités de genre et sexuelles ? Adopter une approche intégrée de la sécurité est une première piste à envisager pour prendre soin, individuellement et collectivement, des personnes engagées au sein de nos organisations. Ces réflexions autour des pratiques organisationnelles en faveur du bien-être, de la même manière que l’ensemble des réflexions autour des questions de genre, ne doivent pas échapper à une vigilance sur les risques de dénaturation et de les vider de leur substance politique. Le glissement du bien-être radical vers le développement personnel a trop souvent été franchi et dénoncé par des penseuses et chercheuses comme Zineb Fahsi, Camille Teste ou Aisha Harris.
CONCLUSION
Souvent pris·e·s dans l’urgence d’agir, et face à l’ampleur des inégalités qui traversent le monde patriarcal, postcolonial et capitaliste dans lequel nous vivons, nous, organisations de solidarité internationale, manquons de temps pour porter un regard critique, politique et historique sur nos pratiques. En reconnaissant les écueils dans lesquels notre secteur peut tomber, nous souhaitons participer collectivement à sa transformation.
Ce dossier propose un espace pour nourrir cette réflexion. Il est une mise en dialogue des apports des réflexions féministes – issues du monde militant comme de la recherche – avec les pratiques du secteur de la solidarité internationale.
Il s’agit d’une invitation à l’autoréflexivité, à la reconnaissance des biais intériorisés qui nous façonnent et à la visibilisation de pensées et outils issues des approches féministes et décoloniales.
Les chercheur·se·s, militant·e·s, théoricien·ne·s et philosophes féministes nous interpellent depuis longtemps. Leurs analyses et pistes d’actions offrent des clés précieuses pour faire évoluer nos approches. Faire preuve d’écoute et utiliser ces ressources est une première étape indispensable.
Ce dossier ne prétend pas à l’exhaustivité. Il ouvre des pistes, propose des outils, et invite à poursuivre le travail pour renforcer la solidarité internationale. Repenser son efficacité au prisme de la justice sociale n’est pas un simple souhait, c’est une nécessité, sur laquelle repose la justification même de l’existence de nos structures et de nos initiatives.
NB : Toutes les références sont disponibles dans le dossier complet téléchargeable.
Crédits illustrations : Anina Takeff

