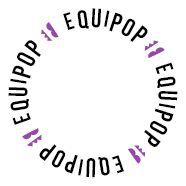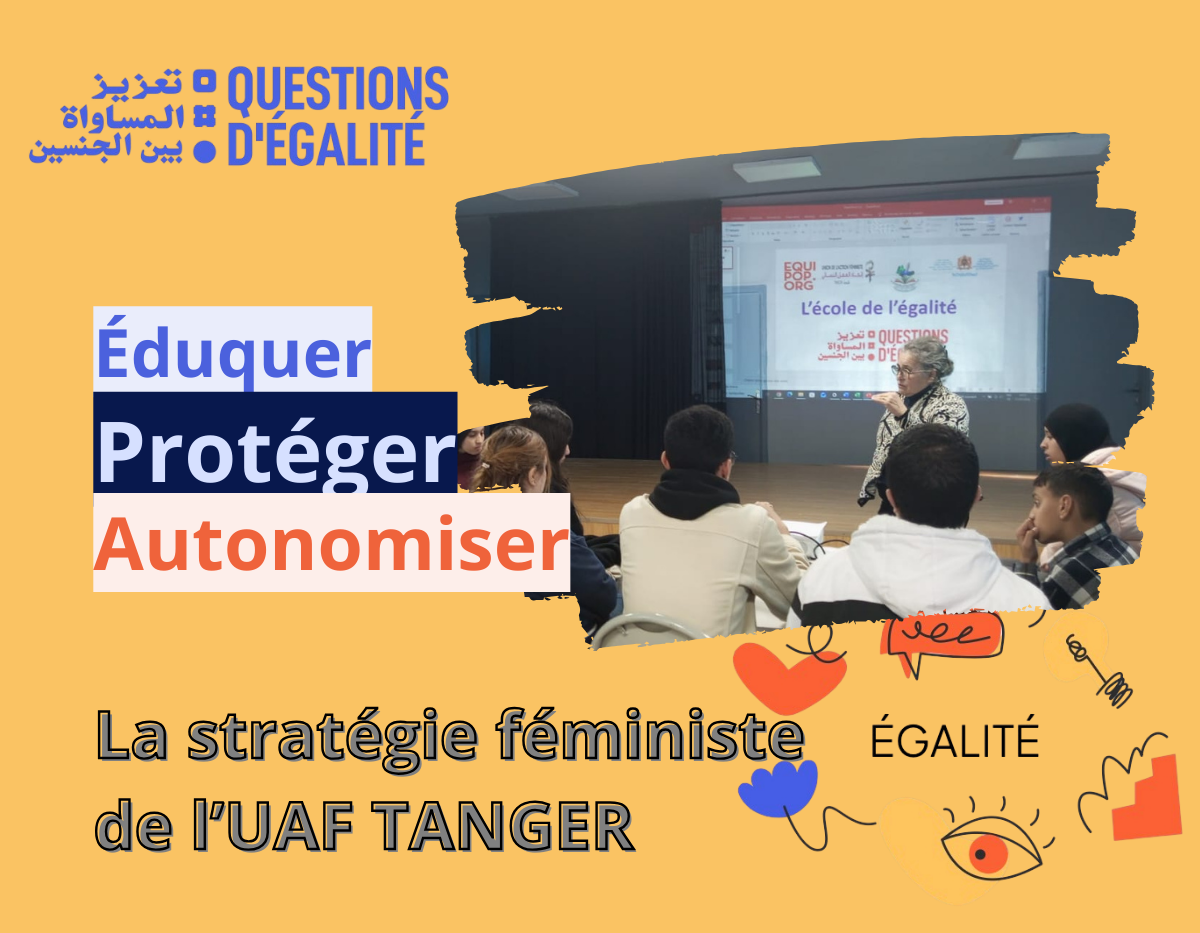Par Dinorah Arceta Casanova, l’une de nos ‘Walkie-Talkies’ dans le cadre du projet Walking The Talk
Du 10 au 15 août 2025, la ville de Mexico a accueilli la XVIe Conférence régionale sur les femmes d’Amérique latine et des Caraïbes (CRM), un espace clé de gouvernance régionale qui a réuni les gouvernements, la société civile, les organisations internationales, les parlementaires et les mouvements sociaux autour du thème « la société du soin ». Cette édition s’est déroulée dans un contexte complexe, marqué par des reculs en matière de droits des femmes, des attaques et des violences à l’encontre des féministes, l’arrêt du financement institutionnel des organisations dirigées par des femmes, et des discours régressifs sur l’égalité des sexes et la diversité sexuelle dans plusieurs pays de la région.
Dans ce contexte, il était essentiel d’examiner la place des politiques étrangères féministes (PEF), car certains gouvernements, comme ceux du Mexique, de la Colombie et du Chili, ont choisi d’adopter officiellement cette approche, tandis que d’autres, comme la Bolivie, sont encore dans le processus de construction. La CRM a été l’occasion d’évaluer de manière critique si ces politiques parviennent à répondre aux besoins réels des femmes dans les territoires ou si elles risquent de devenir des cadres symboliques sans impact transformateur.
Les mouvements féministes de la région réclament « justice fiscale et redevabilité »
Comme le veut désormais la tradition au sein de la CRM, la société civile s’est organisée en amont pour réfléchir collectivement à la coordination de stratégies pour faire face aux atteintes aux droits des femmes dans les territoires. Pendant plus de six mois, des féministes d’Amérique latine et des Caraïbes ont préparé le Forum féministe, qui a réuni plus de 400 femmes le 10 août dernier. La déclaration finale, construite collectivement, a dénoncé le fait que les profondes inégalités auxquelles sont confrontées les femmes dans la région sont liées aux relations de pouvoir héritées du colonialisme, qui se manifestent aujourd’hui sous de nouvelles formes de néocolonialisme telles que l’extractivisme, l’endettement perpétuel et la spoliation des biens communs. L’inaction des États et des organismes multilatéraux face aux guerres, aux génocides et aux crises humanitaires, comme en Palestine, au Yémen, en Haïti ou en Ukraine, a également été soulevée, et une politique fiscale fondée sur la justice féministe et la redistribution des ressources publiques vers celles qui ont été historiquement exclues a été exigée. En outre, des espaces de dialogue horizontal ont été créés, comme le « Pavillon du soin ». Ces derniers ont permis partager des solutions issues des territoires, qui placent le soin et la durabilité de la vie au cœur du dialogue, à partir d’approches intersectionnelles telles que l’antiracisme, l’anti-capacitisme et celles des peuples autochtones et indigènes.
En matière de politique étrangère féministe, le message était clair : Il est inutile d’adopter une PEF si celle-ci ne se traduit pas par des actions concrètes, avec des résultats tangibles en matière de justice fiscale, de construction de la paix et d’élimination des inégalités structurelles. Les PEF ne doivent pas rester de simples cadres symboliques mais doivent être de véritables outils de transformation. Face à la montée du backlash antiféministe dans la région, un appel a été lancé pour renforcer l’unité du mouvement féministe latino-américain et caribéen, afin que les États et les acteurs qui promeuvent les PEF comme des « modèles internationaux » ne restent pas silencieux face aux reculs en Amérique latine et dans les Caraïbes. Leur silence reviendrait à se rendre complices.
L’abandon du label « féministe » dans les PEF
Au moins trois événements parallèles à la XVIe CRM ont abordé les progrès des PEF dans la région. Dans le panel « Contributions de la politique étrangère féministe à la construction de sociétés du soin en Amérique latine et dans les Caraïbes », il a été souligné que le concept du soin en tant que droit a été développé il y a bien des années par les mouvements féministes, amenant même à son inclusion dans le Consensus de Brasilia en 2010. Mais c’est la pandémie de COVID-19 qui a démontré à l’échelle mondiale que « les soins soutiennent la vie », en encourageant leur intégration dans les agendas internationaux. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la PEF a contribué à la création de l’Alliance mondiale pour les soins et l’Engagement de Séville. Cependant, le démantèlement des institutions chargées des questions de genre et le recul de la coopération internationale menacent gravement les droits et la vie de nombreuses femmes. Dans les espaces multilatéraux, des concepts tels que « femme » et « genre » se heurtent à une résistance croissante, ce qui rend difficile le maintien de l’approche féministe sans perdre son essence. C’est pourquoi il a été souligné que la PEF doit produire des résultats concrets, tels que l’intégration du soin dans les politiques macroéconomiques, sans même utiliser le terme de « féministe ». Dans ce contexte, les soins pourraient constituer une voie stratégique pour faire avancer l’agenda féministe face au rejet que suscite encore ce terme.
Lors de l’événement « Les politiques étrangères féministes contribuent-elles à faire progresser les droits des femmes et l’égalité des genres ? » , des féministes du Chili, de Colombie, d’Argentine, de Bolivie et du Mexique ont présenté une évaluation critique de l’impact des PEF dans leurs pays. Il a été souligné la nécessité de construire un modèle latino-américain propre, axé sur la société du soin, la coopération Sud-Sud et l’éradication des violences structurelles, telles que la violence sexuelle, la violence armée et les approches sécuritaires de la migration, dans une perspective participative et fortement ancrée dans les mouvements sociaux féministes. Il a également été rappelé que bon nombre des initiatives promues par les PEF ne sont pas nouvelles, mais s’inscrivent dans le cadre de luttes historiques, et que pour être véritablement féministes, ces politiques doivent intégrer les thèmes prioritaires du féminisme au sein et en dehors de leurs territoires. De même, il a été souligné l’importance de veiller à ce que les instruments internationaux relatifs aux droits des femmes ne restent pas de simples engagements formels, mais soient appliqués afin de transformer les conditions de vie au niveau local. Les participantes ont remis en question la cohérence des dirigeants internationaux qui promeuvent une image féministe tout en bafouant les droits des femmes au niveau national et local. Le manque de participation réelle à l’élaboration des PEF (en particulier au Mexique) et le silence de certains gouvernements face aux reculs en matière de droits sexuels et reproductifs et la progression de la militarisation ont également été dénoncés. Enfin, un appel a été lancé pour apporter aux institutions liées aux PEF des ressources, de la force politique et de la proximité avec les mouvements de femmes, y compris la reconnaissance des diplomates en tant que sujets de droits, qui sont également confrontées à la violence sexiste sur leur lieu de travail.

Enfin, l’événement parallèle « Politiques étrangères féministes et société du soin : vers un modèle latino-américain qui favorise l’autonomie des femmes », organisé par le gouvernement mexicain a été particulièrement remarqué. Ce dernier était axé sur l’approche institutionnelle des PEF et présentait comme bonne pratique le « Label égalité des sexes » du PNUD, qui certifie les institutions qui intègrent l’égalité des genres dans leurs structures et leurs processus, contribuant ainsi à la réalisation de l’ODD 5 et au renforcement des capacités institutionnelles en matière de politique étrangère. Le projet « Renforcement de la politique étrangère féministe et de la coopération internationale féministe » a également été présenté. Il vise à consolider les capacités des ministères des Affaires étrangères et des agences de coopération internationale du Chili, de Colombie, du Mexique et d’Allemagne à concevoir des politiques tenant compte de la dimension de genre.
D’autre part, il a été noté que le Mexique, près d’un an après avoir annoncé son programme de politique étrangère féministe et l’avoir élaboré avec une participation limitée (réduite à un sondage et à une consultation de la société civile), a finalement présenté des avancées par le biais du ministère des Affaires étrangères. Le programme vise à promouvoir l’égalité réelle dans tous les domaines de la politique étrangère à travers cinq actions prioritaires dans cinq domaines clés, dont deux sous-secrétariats (Relations extérieures et Amérique latine et Caraïbes) qui n’envisageaient auparavant aucune action s’inscrivant dans le cadre de la PEF. Cela montre que, bien qu’elle n’en soit encore qu’à ses débuts, la PEF continue de s’imposer comme une tendance dans la région, utilisée par certains pays et organismes internationaux pour projeter leur leadership international.
L’engagement de Tlatelolco : un instrument de PEF ?
Les documents La société du soin et l’Engagement de Tlatelolco représentent les principaux résultats de la XVIe CRM. Bien qu’il s’agisse d’instruments négociés principalement par les gouvernements, certaines féministes issues de la société civile ont pu participer aux tables rondes et aux débats pléniers. Le cas du Mexique est particulièrement frappant, où, pour la première fois depuis longtemps, aucun appel public à candidatures n’a été lancé pour constituer la délégation nationale. Au lieu de cela, la sélection a été effectuée de manière discrétionnaire par le Secrétariat aux affaires étrangères et le Ministère des femmes, rompant ainsi avec les pratiques antérieures qui garantissaient une participation collective et transparente de la société civile avec un accès aux espaces de négociation.
Malgré ces limites, le document final a réussi à intégrer des observations importantes de la société civile, en particulier celles qui soulignent la responsabilité incontournable des États de mobiliser des ressources publiques avec la plus grande ambition possible afin de garantir les droits, y compris le droit au soin. Plusieurs organisations avaient exprimé leur inquiétude quant à un éventuel affaiblissement du libellé de l’Engagement de Tlatelolco, notamment en ce qui concerne le financement public comme condition indispensable pour progresser vers une société du soin. Contrairement aux engagements précédents, on a pu constater une tendance inquiétante vers des mécanismes de financement privé, qui sont contraires aux principes de garantie des droits des femmes et des dissidents.
Enfin, une référence claire au financement public a été incluse dans le document, soulignant que, si l’investissement privé peut être complémentaire, il doit se faire par le biais de contributions fiscales progressives, dans le cadre d’un pacte fiscal qui évite la reproduction des inégalités résultant de la privatisation et de la financiarisation des services publics. En ce qui concerne la PEF, l’Engagement de Tlatelolco a conservé le libellé convenu précédemment dans l’Engagement de Buenos Aires, encourageant l’adoption de la PEF en fonction des priorités de chaque État et garantissant la participation pleine, effective et significative des femmes à la diplomatie et aux espaces internationaux.
Conclusions
Il est essentiel de continuer à tirer parti des espaces régionaux de gouvernance pour promouvoir des discussions plus concrètes et contextualisées sur l’utilité réelle des politiques étrangères féministes pour les femmes. Ces espaces, en particulier les forums régionaux multipartites, sont essentiels car ils permettent à la société civile de disposer d’un lieu spécifique de participation et d’interaction directe avec les gouvernements, où elle peut faire connaître ses revendications et proposer des solutions. Contrairement à la diplomatie multilatérale internationale, où persistent des structures davantage marquées par la colonialité du savoir et du pouvoir, les voix féministes des territoires occupent une place prépondérante dans ces espaces. La CRM en est un exemple emblématique : un forum conçu dans le Sud global et pour le Sud global, impulsé par les féminismes latino-américains, qui a permis de positionner un agenda qui lui est propre afin de faire face aux défis régionaux. Face à la montée du mouvement antiféministe tant dans la région qu’à l’échelle mondiale, il est urgent que les PEF contribuent à construire une voix féministe latino-américaine articulée entre la société civile et d’autres acteurs influents, une voix qui lui soit propre, collective et profondément enracinée dans la réalité du Sud global.